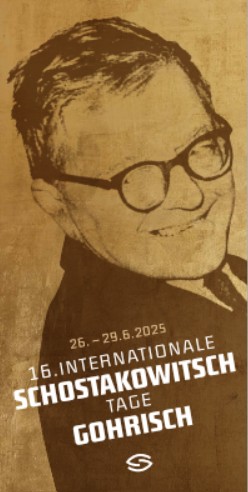Plus de détails
Strasbourg. Opéra national du Rhin. 20-I-2025. Jacques Offenbach (1819-1880) : Les Contes d’Hoffmann, opéra fantastique en cinq actes sur un livret de Jules Barbier et Michel Carré. Édition de Michael Kaye et Jean-Christophe Keck. Mise en scène : Lotte de Beer. Décors : Christof Hetzer. Costumes : Jorine van Beek. Lumières : Alex Brok. Réécriture des dialogues et Dramaturgie : Peter te Nuyl. Avec : Attilio Glaser, Hoffmann ; Lenneke Ruiten, Olympia, Antonia, Giulietta, Stella ; Floriane Hasler, Nicklausse, la Muse ; Jean-Sébastien Bou, Lindorf, Coppélius, Miracle, Dapertutto ; Raphaël Brémard : Andrès, Cochenille, Frantz, Pitichinaccio ; Marc Barrard, Crespel, Luther ; Pierre Romainville, Nathanaël, Spalanzani, le Capitaine des sbires ; Pierre Gennaï, Hermann, Schlémil ; Bernadette Johns, la Mère d’Antonia. Chœur de l’Opéra national du Rhin (chef de chœur : Hendrik Haas), Orchestre philharmonique de Strasbourg, direction : Pierre Dumoussaud
Une succession de numéros musicaux reliés par des dialogues parlés à vocation didactique. Ainsi apparaissent les nouveaux Contes d'Hoffmann que présente l'Opéra national du Rhin. La distribution honnête mais sans flamboyance et la direction carrée de Pierre Dumoussaud ne sauvent pas le spectacle d'une certaine confusion.

Représenter Les Contes d'Hoffmann de Jacques Offenbach amène nécessairement à se poser la question du choix de la version. Rappelons qu'Offenbach mourut en 1880 alors que son œuvre était encore inachevée (particulièrement l'Acte de Giulietta dit « de Venise »), très incomplètement orchestrée et qu'il avait de plus coutume de remanier ses partitions jusqu'au dernier moment. Pour la création le 10 février 1881 à l'Opéra-Comique de Paris, Ernest Guiraud se chargea de réorganiser le matériel disponible, de terminer l'orchestration et rajouta des récitatifs chantés de son cru alors que les auteurs avaient aussi prévu une version avec dialogues parlés conformément à la tradition de l'opéra-comique. Au fil des reprises de l'ouvrage à travers les ans, des numéros apocryphes vinrent même s'y ajouter et contribuèrent aussi à son succès (le très réussi septuor de Raoul Gunsbourg à l'Acte de Venise en 1904 par exemple). Depuis une quarantaine d'années, au fur et à mesure des redécouvertes de manuscrits d'Offenbach, de partitions d'orchestre oubliées ou de pages du livret censurées, les musicologues Michael Kaye et Jean-Christophe Keck tentent de s'approcher au plus près des intentions initiales du compositeur. De ce travail toujours en cours, plusieurs versions ont vu le jour sans qu'aucune ne puisse jamais être considérée comme définitive.
L'Opéra national du Rhin s'est donc basé sur leurs études pour proposer « sa » version. Avec Lotte de Beer à la mise en scène, il a fait le choix d'une version avec dialogues parlés écrits par Peter de Nuyl qui déplacent le centre de gravité de l'œuvre. C'est cette fois la Muse/Nicklausse qui est le maître du jeu. Descendue de l'Olympe pour assister l'écrivain Hoffmann dans son accomplissement artistique, elle n'aura de cesse de lui démontrer que la succession de ses amours malheureuses, réelles ou imaginées, n'est due qu'à son nombrilisme, son narcissisme, son masculinisme triomphant qui ne tiennent jamais compte des désirs et de la psychologie des femmes rencontrées, lesquelles ne sont que des figures stéréotypées issues de son imagination et sans profondeur. Deux Hoffmann s'affrontent (le chanteur est doublé sur scène par un figurant) : l'artiste aux aspirations supérieures et l'homme gouverné par ses pulsions qui se réconcilieront à l'épilogue. Le gros inconvénient est que ces dialogues, qui compliquent la narration plus qu'ils ne l'éclairent et le plus souvent donnés devant le rideau fermé pendant que le décor change, hachent la continuité du spectacle qui en devient une suite de numéros musicaux pas toujours évidente ni logique. L'Acte de Venise en apparaît particulièrement décousu.

Sur le plan visuel, le décor de Christof Hetzer en perspective raccourcie n'est pas particulièrement seyant, avec son papier peint défraîchi ou sa grotesque poupée géante animée. Il projette en revanche très bien les voix, trop bien même parfois. Lotte de Beer n'oublie pas le côté fantastique avec des changements d'échelle des éléments du décor (tables et chaises de la taverne, poupées de l'acte d'Olympia) ou avec un acte d'Antonia très réussi où bouquets, mains, le Docteur Miracle et même la Mère d'Antonia sortent des tableaux accrochés au mur. Là aussi, l'Acte de Venise convainc moins avec ses péripéties peu claires et son chœur à l'étroit dans l'espace réduit. Chez Lotte de Beer, les quatre incarnations du Mal sont plus ridicules qu'inquiétantes et celles des quatre femmes se conforment à un idéal féminin fantasmé par les hommes, qu'il soit érotique ou domestique.
Dans le rôle ici central de Nicklausse/la Muse, Floriane Hasler est la véritable vedette de la soirée. Elle y est éblouissante tant dans la qualité de la diction et la véracité dramatique des dialogues que dans le chant ambré, bien projeté, nuancé et sensible. Il faut attendre le troisième acte d'Antonia pour que son air « Vois sous l'archet frémissant » apporte enfin lyrisme et émotion au spectacle. Pour Hoffmann, Attilio Glaser possède l'ambitus, la puissance et l'endurance ce qui est déjà beaucoup pour ce rôle écrasant. Cependant, le timbre et l'aigu claironnants, l'émission forte permanente, la difficulté à alléger sans détimbrer ne lui permettent pas d'apporter de nuances, de fêlures ou tout simplement d'humanité à son personnage, finalement assez monolithique et peu évolutif. Lenneke Ruiten relève le défi d'incarner les quatre personnages féminins aux vocalités si différentes. Comme souvent dans cette option, on y gagne en vérité dramatique mais on y perd sur le plan strictement musical. Pour Olympia, « Les oiseaux dans la charmille » est propre, les coloratures sont assurées mais sans folie ni liberté. Pour Antonia, la voix assez mince manque tout de même de corps et de lyrisme pour émouvoir. C'est finalement dans Giulietta, ici dans une tessiture plus aigüe et moins mezzo-soprano que d'habitude, qu'elle tire le mieux son épingle du jeu.

Jean-Sébastien Bou occupe les quatre rôles diaboliques avec beaucoup de faconde, d'autorité et de puissance , son registre grave étant cependant moins sonore. Successivement Andrès, Cochenille, Frantz et Pitichinaccio, Raphaël Brémard assure avec talent et sans en faire trop l'aspect comique et surtout bien chanté des rôles. Marc Barrard fait comme toujours preuve de présence et de probité vocale en Crespel et Luther. Pierre Romainville donne un fort relief à Nathanaël et Spalanzani tandis que Pierre Genaï est impeccable en Hermann et Schlémil. Enfin, Bernadette Johns campe une Mère d'Antonia intense, à la voix chaude et sonore, qui contribue grandement à faire décoller le final du troisième acte. Cantonné le plus souvent dans les loges d'avant-scène ou en fond de scène, le Chœur de l'Opéra national du Rhin y perd en impact et en cohésion, victime de plusieurs décalages avec l'orchestre.
À la tête d'un Orchestre philharmonique de Strasbourg puissant et engagé, Pierre Dumoussaud dirige net et marqué. Depuis le parterre et avec la configuration en conque du décor qui projette le son vers la salle, l'intensité est souvent trop forte sans cependant jamais couvrir les voix. D'un caractère affirmé, cette direction manque en corollaire parfois de subtilité, de colorations ou de douceur pour les atmosphères plus nocturnes. Si la Muse de Floriane Hasler recueille tous les suffrages au rideau final, ce sont des applaudissements plus modérés qui saluent le reste de la distribution, le chef et l'équipe de mise en scène. Ce spectacle sera repris à l'Opéra-Comique de Paris, à l'Opéra de Reims et au Volksoper de Vienne qui l'ont coproduit.
Crédits photographiques : Attilio Glaser (Hoffmann), Floriane Hasler (Nicklausse/La Muse) / Attilio Glaser (Hoffmann) / Floriane Hasler (Nicklausse/La Muse), Lenneke Ruiten (Giulietta), Attilio Glaser (Hoffmann), Choeur de l'Opéra national du Rhin © Klara Beck
Plus de détails
Strasbourg. Opéra national du Rhin. 20-I-2025. Jacques Offenbach (1819-1880) : Les Contes d’Hoffmann, opéra fantastique en cinq actes sur un livret de Jules Barbier et Michel Carré. Édition de Michael Kaye et Jean-Christophe Keck. Mise en scène : Lotte de Beer. Décors : Christof Hetzer. Costumes : Jorine van Beek. Lumières : Alex Brok. Réécriture des dialogues et Dramaturgie : Peter te Nuyl. Avec : Attilio Glaser, Hoffmann ; Lenneke Ruiten, Olympia, Antonia, Giulietta, Stella ; Floriane Hasler, Nicklausse, la Muse ; Jean-Sébastien Bou, Lindorf, Coppélius, Miracle, Dapertutto ; Raphaël Brémard : Andrès, Cochenille, Frantz, Pitichinaccio ; Marc Barrard, Crespel, Luther ; Pierre Romainville, Nathanaël, Spalanzani, le Capitaine des sbires ; Pierre Gennaï, Hermann, Schlémil ; Bernadette Johns, la Mère d’Antonia. Chœur de l’Opéra national du Rhin (chef de chœur : Hendrik Haas), Orchestre philharmonique de Strasbourg, direction : Pierre Dumoussaud