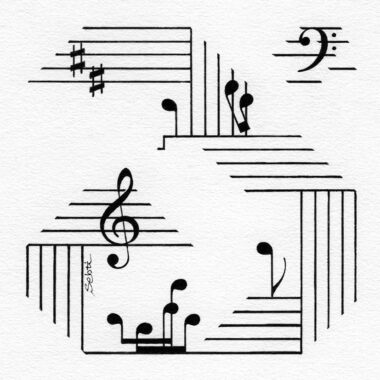Simon Rattle et le LSO jouent Sibelius et Bruckner à la Philharmonie de Paris
Plus de détails
Paris. Philharmonie. Grande Salle Pierre Boulez. 14-I-2023. Jean Sibelius (1865-1957) : Les Océanides en ré majeur op. 73 ; Tapiola en si mineur op. 112 ; Anton Bruckner (1824-1896) : Symphonie n° 7 en mi majeur. London Symphony Orchestra, direction : Sir Simon Rattle.
Dans une magnifique fête orchestrale, Simon Rattle et le LSO exaltent avec brio les paysages épurés sibéliens des Océanides et de Tapiola mais échouent à rendre compte de la ferveur brucknérienne dans la Symphonie n° 7.

Simon Rattle pratique Sibelius depuis de nombreuses années avec deux intégrales du corpus symphonique à son actif (City of Birmingham et plus récemment Philharmonique de Berlin). C'est à la tête du LSO dont il est actuellement le directeur musical qu'on le retrouve ce soir pour les deux derniers poèmes symphoniques du Maitre : Les Océanides (1914) et Tapiola (1926) ; une ultime production qui préludera à un long silence de trente ans.
Les Océanides se réfèrent à la mythologie homérique dans l'évocation très impressionniste, quasi debussyste, de la mer et de ses nymphes mystérieuses ; une courte pièce rarement donnée en concert d'un statisme angoissant scandé pianissimo par les roulements de timbales, bercée par les lancinantes oscillations de la houle (trémolos de cordes graves), juste troublées par les sonorités fluides et très aquatiques de la harpe et des bois, avant que le phrasé ne s'anime en recrutant les cuivres dans un grand crescendo bien conduit précédant l'embellie finale sereine qui marque le retour à la paix immense et solitaire de la mer…
Bien différent et d'une dimension plus ambitieuse, Tapiola revient à la légende scandinave du Kalevala célébrant Tapio, dieu des forêts, tout en récapitulant en quelque sorte toute la « manière sibélienne » qui associe rigueur et perfection formelle dans ce chef-d'œuvre absolu. Bien plus qu'une simple pièce narrative, Tapiola restitue la vision d'un monde vierge, sauvage et désolé, primitif et terrifiant, figurant l'affrontement entre les forces élémentaires (récurrence obsédante du thème, bribes musicales, dissonances, clusters, crescendo cataclysmique). Là encore, on admire tout à la fois, la maestria de la direction, la clarté de la texture orchestrale, les performances individuelles et collectives du LSO se déployant au sein d'un phrasé tendu, haletant chargé d'un sentiment d'attente qui alterne judicieusement, dans une succession haute en couleurs, les épisodes de tension et de détente, avant qu'un magnifique crescendo (cordes) ne mette un terme à ce véritable « voyage intérieur » cathartique, autorisant alors un retour au calme apaisé.
Quand on sait l'admiration que Sibelius portait à Bruckner, la Symphonie n° 7 (1884) du ménestrel de Dieu trouve naturellement sa place en seconde partie de concert. Une symphonie contemporaine d'une première version du Te Deum qui utilise pour la première fois les tubas wagnériens témoignant ainsi de l'admiration éperdue du compositeur pour Richard Wagner. Fortement spiritualisée, Simon Rattle nous en livre, a contrario, une interprétation radieuse mais très immanente et agnostique qui soulève bien des réserves : car si l'on souscrit à la clarté et à l'allègement de la texture, comme à l'exceptionnelle plastique orchestrale du LSO, on est en revanche surpris par le manque de verticalité, de tension et de ferveur du discours, tout particulièrement dans les deux premiers mouvements. En cherchant de manière forcenée le « beau son », il nous offre une lecture toute apollinienne, d'une irréprochable beauté formelle (clarté, sonorité, mise en place) mais où manque hélas l'essentiel… l'âme brucknérienne !
Allegro moderato, le premier mouvement est imprégné d'un lyrisme (cordes) presque galant, totalement décalé, qui manque singulièrement de caractère et de tension, se perdant quelque peu dans un phrasé déliquescent et maniéré (rupture dans la continuité du discours, nuances rythmiques et dynamiques excessives) sur un tempo exagérément lent. L'Adagio souffre des mêmes reproches, trop lent et fracturé, étrangement exempt de tout sentiment de deuil (mort de Wagner), fade et sans ferveur. On en retient toutefois les performances irréprochables de la petite harmonie, la sombre sonorité solennelle des tubas wagnériens, le lyrisme des cordes et les cinglants coups de cymbales et de triangle à l'acmé du crescendo final. Plus réussi, annoncé par la trompette, le Scherzo fait montre d'une puissante et tumultueuse énergie (cordes, petite harmonie, cuivres) entourant un Trio central aux allures populaires superbement introduit par les timbales. Le Finale poursuit sur une dynamique retrouvée et bien contenue, empreinte d'une solennité cuivrée avant de se résoudre en une coda éclatante.
Crédit photographique : © Mark Allan
Plus de détails
Paris. Philharmonie. Grande Salle Pierre Boulez. 14-I-2023. Jean Sibelius (1865-1957) : Les Océanides en ré majeur op. 73 ; Tapiola en si mineur op. 112 ; Anton Bruckner (1824-1896) : Symphonie n° 7 en mi majeur. London Symphony Orchestra, direction : Sir Simon Rattle.