Plus de détails
Besançon. Musée des beaux-arts et d’archéologie. Exposition « Choré-graphies. Dessiner, danser/ XVIIe-XXIe siècles ». Présenté avec l’Institut national d’histoire de l’art (INHA). En collaboration avec le Centre national de la danse et la Bibliothèque national de France Commissariat de l’exposition : Pauline Chevalier et Amandine Royer. Du 19 avril au 21 septembre 2025.
Catalogue d’exposition, éditions INHA-Lienart. Avril 2025. 30€
L'Institut national d'histoire de l'art (INHA) et le Musée des beaux-arts de Besançon s'associent pour Choré-graphies, une exposition s'intéressant aux représentations de la danse par le dessin du XVIIe au XXIe siècle.

Issue d'un programme de recherche sur la danse et le dessin mené depuis 2018 par Pauline Chevalier à l'INHA, en collaboration avec le Centre national de la danse et la Bibliothèque national de France, l'exposition sur un aspect peu connu de cet art, présente environ 250 œuvres, prêtées par différentes institutions (Opéra national de Paris, musées) et chorégraphes. Seront particulièrement intéressés par cet énorme travail, bien sûr les spécialistes de la danse mais également les amateurs d'archives et de carnets de note en tous genres.
La scénographie très studieuse se décline en teintes pastels dans six espaces d'exposition temporaire tranchant avec le cœur de béton coffré du musée dont on admire dès l'entrée la splendide rénovation (2018) de la réalisation visionnaire de l'architecte Louis Miquel, un proche de Le Corbusier. Des voiles de tulle évoquant le ballet et des bancs ponctuent par endroits le parcours des vitrines et l'accrochage de nombreux dessins, photos, lithographies et tableaux. Donnant de la verticalité, trois sculptures en bronze de Rodin imagent des mouvements de danse libres contrastant plus loin avec la posture codifiée de ballet classique représentée par une sculpture de Degas.
La première partie « Ecrire la danse » présente l'histoire de la notation chorégraphique, par l'écriture ou le dessin, deux systèmes qui s'affrontent ou se combinent dans leur analyse du mouvement et la façon d'en garder la trace. Une curieuse boite en carton-bois (1852) avec ses caractères d'impression était destinée à la sténochorégraphie, permettant d'écrire rapidement la danse. L'enjeu prend en effet de l'importance au XIXe siècle quand il s'agit de faire reconnaître son droit d'auteur.
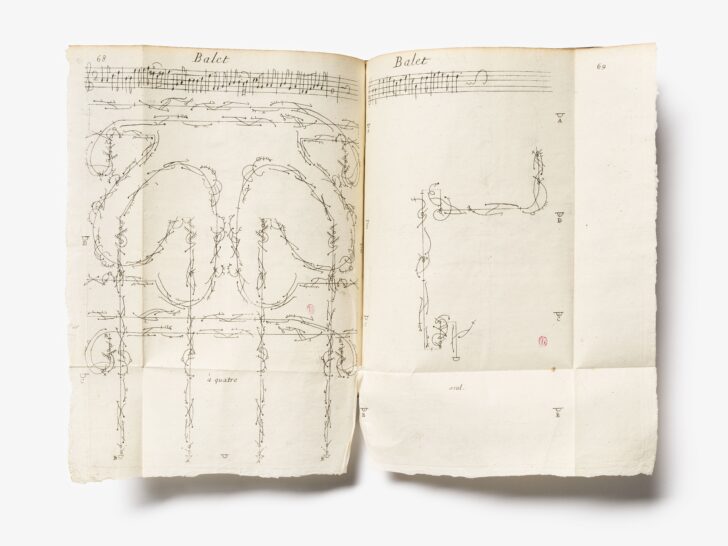
Dans la deuxième section il est question de « Danser ensemble » car la représentation de la danse est un outil de diffusion en société. Partitions, manuels se développent dès le XVIIIe siècles grâce à des feuillets achetés à l'unité qu'on peut ensuite relier. Viendra le tour de la photographie, qui permet la décomposition des mouvements grâce à des planches contacts, avant le film bien entendu.
« Dessiner le ballet » prend de l'importance fin XVIIIe puis durant le XIXe siècle. C'est aussi dans ce contexte que naît le ballet romantique soumis à une dramaturgie. L'inspiration est puisée dans les représentations de la peinture classique, voire de la statuaire antique. Les études de mains et de bras servent aux maîtres de ballet pour imaginer les attitudes des danseurs et danseuses. Beaucoup dessinent mais pas tous. Jules Perrot représenté dans le tableau de Degas, La Classe de danse, alla au procès contre Marius Petipa en 1861 pour faire reconnaître la paternité de certains de ses pas, qu'il ne dessinait pourtant pas.
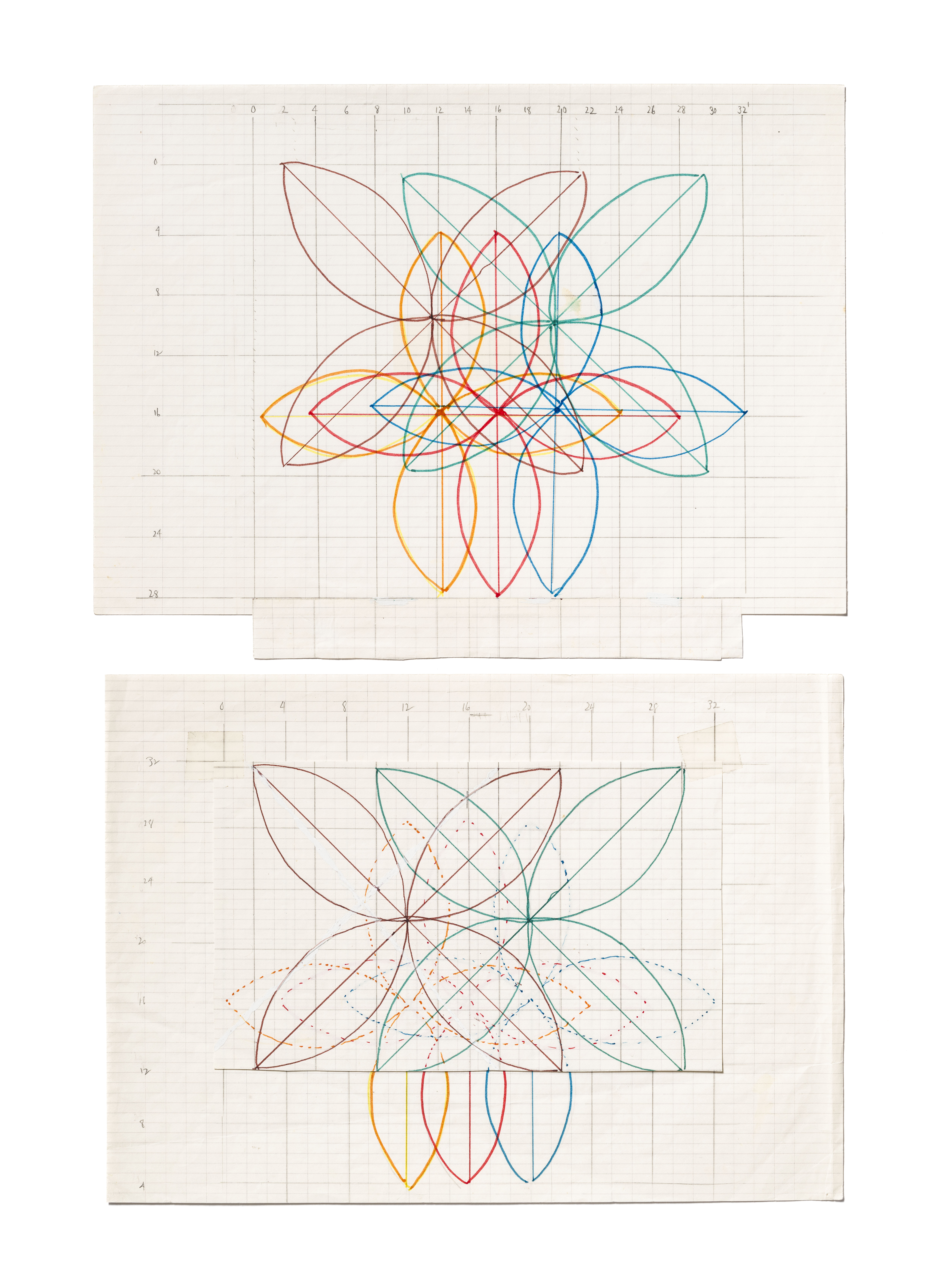 La section « Carnets et partitions » consacrée aux travaux des chorégraphes présente toutes sortes de systèmes de notation (des bâtons, des cercles, des dessins, de la couleur ou pas) et de supports (feuilles, carnets petits ou grands, à carreaux ou pas, au crayon ou au feutre). Il est intéressant de comparer les techniques mises ainsi côte à côte grâce aux prêts du CND et des chorégraphes (Carolyn Carlson, Lucinda Childs…). On peut regretter toutefois que cette partie, qui pourra sembler ardue aux non spécialistes, ne s'anime pas de vidéos montrant les chorégraphies vivantes après les avoir vues couchées sur le papier.
La section « Carnets et partitions » consacrée aux travaux des chorégraphes présente toutes sortes de systèmes de notation (des bâtons, des cercles, des dessins, de la couleur ou pas) et de supports (feuilles, carnets petits ou grands, à carreaux ou pas, au crayon ou au feutre). Il est intéressant de comparer les techniques mises ainsi côte à côte grâce aux prêts du CND et des chorégraphes (Carolyn Carlson, Lucinda Childs…). On peut regretter toutefois que cette partie, qui pourra sembler ardue aux non spécialistes, ne s'anime pas de vidéos montrant les chorégraphies vivantes après les avoir vues couchées sur le papier.
L'abstraction est le thème de la section suivante, ainsi encore plus conceptuelle, s'ouvrant par une très belle et étrange lithographie de Toulouse-Lautrec représentant Miss Loïe Fuller (1893) en pleine danse du voile. La géométrie est pourtant au cœur de la représentation de la danse depuis ses débuts. Cercles, spirales et diagonales ne datent pas d'hier (voir déjà les représentations de contredanses à cheval) mais ces figures, toujours très actuelles, sont particulièrement utilisées chez Anne Teresa De Keersmaeker par exemple. Plusieurs écrans suspendus occupent un espace pour recréer la pièce Les temps suspendus de Myriam Gourfink utilisant un logiciel de composition chorégraphique, et datant déjà de 2009 alors que l'IA n'était pas encore dans tous les esprits.
C'est d'ailleurs avec La Machine que se termine l'exposition. Borne interactive de la compagnie Labkine, façon juke box, elle permet au visiteur de reproduire des mouvements de danse tirés de partition de chorégraphes contemporains. Une façon au bout du compte de lier la théorie à la pratique.
Crédits photographiques : photo de Une : René-Xavier Prinet « Entre amies » © Musée des beaux-arts de Besançon ; photo in situ © ResMusica ; Raoul Auger feuillet, « Chorégraphie ou L'art de d'écrire la dance » © INHA ; Lucinda Childs, deux gabarits pour Melody © Centre national de la danse
Lire aussi :
Plus de détails
Besançon. Musée des beaux-arts et d’archéologie. Exposition « Choré-graphies. Dessiner, danser/ XVIIe-XXIe siècles ». Présenté avec l’Institut national d’histoire de l’art (INHA). En collaboration avec le Centre national de la danse et la Bibliothèque national de France Commissariat de l’exposition : Pauline Chevalier et Amandine Royer. Du 19 avril au 21 septembre 2025.
Catalogue d’exposition, éditions INHA-Lienart. Avril 2025. 30€





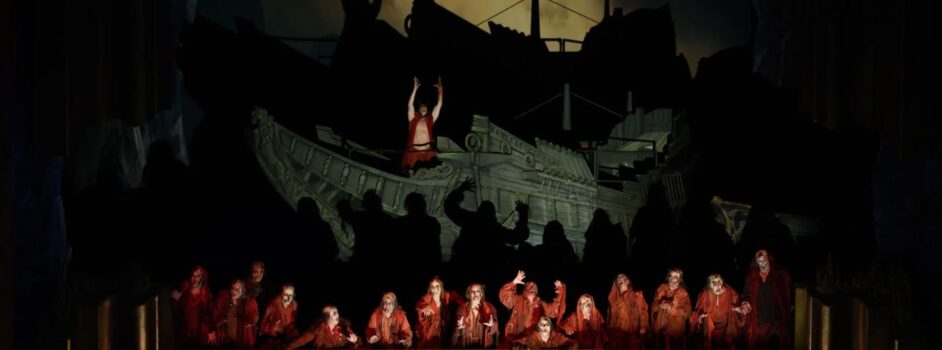
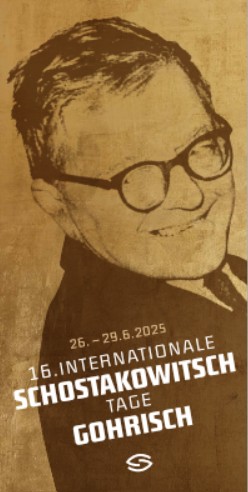

Si limpide explication de l’évolution de l’écriture chorégraphique.
Aller + loin maintenant à Besançon.
Pour cette exposition.