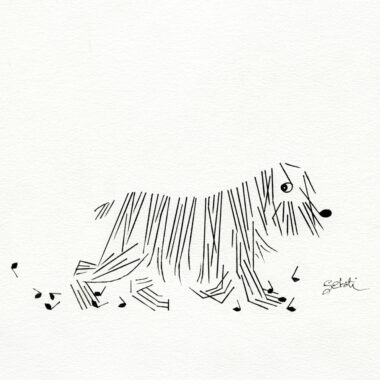Plus de détails
Centre national du costume et de la scène à Moulins (Allier). Exposition Christian Lacroix en scène. Commissariat : Christian Lacroix et Delphine Pinasa. Scénographie : Véronique Dollfus Jusqu’au 4 janvier 2026.
Le Centre national du costume et de la scène de Moulins expose 140 costumes signés Christian Lacroix pour des opéras, ballets, pièces de théâtre… Une valse réjouissante de couleurs, de rigueurs et de folies !

« Bienvenue à ce que vous croyez voir ! » William Forsythe, le trublion de la danse néo-classique avait usé de cette devise provocante dans les années 90. Le costumier Christian Lacroix pourrait tout à fait faire sienne cette formule, et c'est ce que l'on redécouvre dans cette troisième exposition que lui consacre le très beau CNCS de Moulins dans l'Allier. Car si l'on regarde bien les cartels détaillés de chaque vêtement exposé, on découvre un nombre incroyable de matières par costume, et si l'on sait que bon nombre d'entre ces matières sont issues de costumes existants et recyclés, ou qu'il y a du plastique derrière une robe XIXe et du crin de cheval sur une perruque, on voit alors combien chaque costume est riche de multiples histoires insoupçonnables.
Des histoires, il y en a plein qui s'emboitent dans cette exposition : celle du costume au fil des siècles, le déroulé autobiographique des œuvres du maître, le vécu de chaque pièce. Mais aussi à tout un panorama de la production théâtrale et lyrique européenne de ces vingt dernières années, dès lors qu'elle est portée par un souci d'historicité du costume.
 Christian Lacroix a donc choisi une exposition chronologique. Non pas celle de ses œuvres, depuis ses premiers costumes de scène en 1986 (l'exposition ici, remonte à 2007). Mais, en bon amoureux de l'histoire du vêtement, il a opté pour une chronologie de ses productions par époques stylistiques, depuis la Renaissance pour Roméo et Juliette et La Vie de Galilée, jusqu'à la « fin de siècle » avec Lohengrin, Pelléas et Melisande, Fantasio ou L'Hôtel du Libre-Echange.
Christian Lacroix a donc choisi une exposition chronologique. Non pas celle de ses œuvres, depuis ses premiers costumes de scène en 1986 (l'exposition ici, remonte à 2007). Mais, en bon amoureux de l'histoire du vêtement, il a opté pour une chronologie de ses productions par époques stylistiques, depuis la Renaissance pour Roméo et Juliette et La Vie de Galilée, jusqu'à la « fin de siècle » avec Lohengrin, Pelléas et Melisande, Fantasio ou L'Hôtel du Libre-Echange.
Lacroix, dernier « dinosaure » qui avoue de ne pas pouvoir créer des costumes au-delà du début du XXe siècle, nous épargnant ainsi d'énièmes nuisettes, jeans ou costumes cravates qui cherchent à nous convaincre que Don Giovanni, La Flûte Enchantée ou Aïda peuvent, oui, se dérouler aussi de notre temps. Le visiteur voyage donc dans neuf époques différentes, des robes à panier et habits brodés des Noces de Figaro (mise en scène James Gray, 2019, TCE) à la sobre robe klimtienne de Melisande ponctuée d'une immense perruque rousse conçues pour Patricia Petibon dans la mise en scène d'Eric Ruf (Théâtre des Champs-Elysées, 2017) .
On découvre alors à quel point le couturier-costumier aime par-dessus tout relever le pari de la reconstitution du costume d'époque (comme pour ces Noces), voire même des costumes du spectacle à sa création, comme pour Carmen (2023) ou Le Postillon de Longjumeau mis en scène par Michel Fau. Mais il aime aussi mélanger les factures et origines de tissus comme ces femmes de La Vie de Galilée dont la jupe beige est un simple tissu de sari indien chiné à Paris, qui s'enlève pour ne laisser place qu'à un corset de petite vertu façon XVIIe siècle.
On comprend aussi que ce XVIIe et le XVIIIe sont des périodes qu'il affectionne, lui permettant tous les excès de l'époque, à l'image des pièces de Molière (Georges Dandin, Le Bourgeois Gentilhomme, L'Amour médecin..) ou des fastes baroques musicaux du moment. On retrouve ainsi avec joie une étonnante robe bleue de l'Ezio de Gluck (Opéra de Francfort 2013) et surtout les insensés costumes du Polifemo de Porpora monté à Versailles en 2024, entre jupes en écailles pour les hommes, robes et perruques (en tulle) démesurées pour les femmes, et même un figurant mouton avec de la vraie laine de l'animal sur le torse !
Mais on aime aussi voyager avec lui dans des ailleurs exotiques revisités notamment pour une évidente Madame Butterfly avec des kimonos de geishas sublimes, en patchworks, mais aussi d'impressionnantes mousmées arabes du Peer Gynt d'Ibsen monté par Eric Ruf à la Comédie-Française. Seule incursion dans le monde de la danse : les plus qu'originaux costumes de la Cendrillon montée par Tamara Rojo pour le ballet royal de Suède, aves des tutus en rafia et boules de Noël.
Il y a chez Lacroix quelques traits obsessionnels comme la couleur (notamment le rouge, mais aussi de manière inattendue, le noir), la dentelle, les nœuds noirs, l'habit provençal , l'habit chic ou la robe de chambre, les mariées (toute une vitrine leur sont consacrées), la religion, avec cette impressionnante dernière salle, où sa procession de squelettes d'ecclésiastiques de l'Aïda montée par Johannes Erhart à Cologne (2011) côtoie des anges volants dans les airs, veillant sur la lumineuse cape papale de La Vie de Galilée (montée par Eric Ruf à la Comédie-Française, 2019), mais aussi des prostituées de Mahagonny (Staatsoper Berlin, 2014) Le tout sous la haute surveillance d'une boule à facettes…

Quant aux équipes artistiques qui font appel à lui, on distingue vite à quel point Lacroix est un homme « de bande ». Ultra fidèle à Vincent Boussard qui l'a emmené depuis un fameux Didon et Enée (TCE, 2001) dans toutes les grandes maisons d'opéra d'Europe, et surtout en Allemagne. Et pour le théâtre (et quelques opéras), une collaboration sans faille avec Eric Ruf, l'acteur, metteur en scène, scénographe et administrateur de la Comédie-Française : Roméo et Juliette de Gounod à l'Opéra Comique (2021) donné avec les mêmes costumes que pour le Roméo de Shakespeare à la Comédie-Française, La Bohème au Théâtre des Champs-Elysées (2023). Sans oublier Denis Podalydès ou Michel Fau.
De nombreuses institutions ont joué le jeu et prêté leurs costumes notamment les opéras allemands (Berlin, Hambourg, Munich..), la Comédie-Française, l'Opéra Comique, les Bouffes du Nord ou l'Opéra royal de Versailles, autant de maisons où Christian Lacroix a ses habitudes. Une fois n'est pas coutume, la scénographie apporte aussi une pointe de décors (ce qui tranche avec les expositions précédentes si souvent sur fond neutre) avec de magnifiques drapés faisant office de rideaux de scène, qu'ils soient en fond de vitrine ou bien au sol, donnant ainsi une vie supplémentaire au costume.

On aurait aimé en savoir plus sur les pérégrinations de Christian Lacroix lorsqu'il s'attelle à un costume. Qu'il nous dissèque un vêtement – via des vidéos – et en fasse une autopsie détaillée. Combien de matières de toutes origines retrouve-t-on sur un seul costume ? Lesquelles alors, sont issues d'anciens costumes ou pas, sont des matières humbles ou précieuses, chinées aux puces ou chez des fournisseurs haut de gamme ? On aurait aimé aussi voir davantage d'extraits de ces spectacles pour lesquels ces costumes – prenant alors vie – ont été conçus. Autre point de réflexion : depuis des décennies, et même depuis l'enfance, après avoir eu vent, à l'âge de huit ans, d'une certaine Carmen mise en scène par Raymond Rouleau à l'Opéra de Paris en 1959, Lacroix possède une impressionnante banque de données d'images, de tissus, documents, découpages, archives incroyables sur le costume et la vie quotidienne au fil des siècles, dans lesquels il puise ses idées. On adorerait pénétrer dans cette précieuse caverne d'Ali Baba, mentale et réelle. Bref, entrer dans les coulisses de sa créativité avec, pourquoi pas, une vitrine dédiée qui aurait reconstitué cet atelier. Pouvons-nous attendre cela pour une quatrième exposition qui lui sera consacrée, lorsqu'auront été inventoriées l'ensemble de ses archives , qu'il a récemment confiées au CNCS ? Un lieu dont il dit que, s'il avait existé dès son enfance, il aurait été « mort de joie »…
Au sortir de cette exposition temporaire, il ne faut pas oublier de visiter les superbes salles permanentes consacrées à Noureev, le récent bâtiment consacré à la scénographie et le tout nouvel espace montrant quelques « Trésors de la Collection » (avec entre autre, le costume de Dom Juan signé Christian Bérard et porté par Louis Jouvet en 1947), un tutu pour Yvette Chauviré, l'étonnante robe en skaï pour Macbeth vue par Thierry Mugler, une robe de Cendrillon illuminée de l'intérieur, ou l'immense robe rouge de Marie-Antoinette décapitée qui fît sensation à la cérémonie d'ouverture des JO Paris 2024).
Crédits photographiques : Costume pour le rôle d'Adrienne Lecouvreur dans l'opéra Adrienne Lecouvreur de Francesco Cilea, 2012. Création Christian Lacroix. Coll. CNCS / Don Opéra de
Francfort © CNCS / Florent Giffard ; photos in situ © CNCS/ C. Delterme
Plus de détails
Centre national du costume et de la scène à Moulins (Allier). Exposition Christian Lacroix en scène. Commissariat : Christian Lacroix et Delphine Pinasa. Scénographie : Véronique Dollfus Jusqu’au 4 janvier 2026.