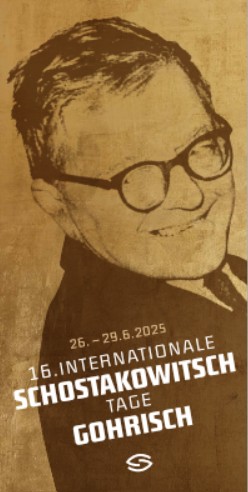Plus de détails
Alors que le chef américain nous a quittés au début du mois, nous transcrivons ci-dessous une interview qu'il avait accordé à notre correspondant suisse en février 1998 alors qu'il s'apprêtait à diriger une série de six représentations concertantes de La Damnation de Faust de Berlioz au Victoria Hall de Genève.

Pour la petite histoire si, lors de ces représentations, trois sopranos (Béatrice Uria-Monzon, Diana Montague et Marie-Ange Todorovitch) se sont succédées dans les habits de Marguerite, et deux ténors (Steven Cole et Daniel Galvez-Vallejo) ont vêtu ceux de Faust, l'inusable José Van Dam fut l'impitoyable Méphistophélès pendant les six représentations. Le Chœur du Grand Théâtre de Genève appuyé par le Chœur complémentaire du Grand Théâtre de Genève et l'Ensemble Vocal Orpheus de Sofia soit, au total, près de 90 choristes envahissaient l'arrière scène du Victoria Hall derrière un Orchestre de la Suisse Romande au grand complet sous les ordres d'un John Nelson toujours aussi passionné par ce Berlioz dont il ne tarissait pas d'éloges pour sa musique.
Jacques Schmitt : Comment s'est passée votre rencontre avec ce compositeur ?
John Nelson : Comme souvent au départ d'une carrière, j'ai eu la chance de me trouver au bon endroit au bon moment. Aujourd'hui directeur artistique de l'Opéra de Chicago, Matthew Epstein est une personnalité importante du monde de l'opéra. Je l'ai rencontré quand il était directeur artistique de Columbia Records. Il avait alors 21 ans ! En discutant de projets musicaux, il m'a suggéré de m'intéresser aux Troyens, l'opéra de Berlioz.
Je ne connaissais même pas l'existence de cet opéra. J'ai lu la partition et écouté l'enregistrement. Cela m'a totalement envoûté. Mais comment monter une œuvre aussi énorme ? Cinq heures de musique, deux orchestres, deux chœurs, seize solistes. Mais, mon jeune ami y croyait. Il a trouvé les solistes. J'ai engagé mon chœur et l'orchestre a été recruté parmi des musiciens free-lance. En 1972, en version de concert, Les Troyens faisaient leur entrée au Carnegie Hall de New York.
JS : Avec succès ?
JN : Un succès immense. Encore aujourd'hui, on en parle comme d'un événement exceptionnel. Le public n'avait jamais entendu une telle musique, ni une telle sonorité orchestrale. Du haut de mes 26 ans, je suis devenu, du jour au lendemain, le nouveau grand chef d'orchestre des générations futures. Une montagne d'éloges. Cela m'a valu d'être remarqué par le chef d'orchestre Raphaël Kubelik qui m'a engagé comme assistant au Metropolitan Opera de New York pour la production scénique des Troyens. Alors qu'il était gravement malade, il m'a demandé de le remplacer au pupitre après la première représentation. Il n'en fallait pas plus pour que Berlioz entre dans ma vie, dans ma famille. Voilà trente ans que je vis avec le musicien, l'écrivain et l'homme.
Depuis, bien des théâtres lyriques ne conçoivent plus de monter un de ses opéras sans penser à moi pour le diriger. A Genève, j'ai dirigé Les Troyens dans la production de Jean-Claude Riber en septembre 1974. (ndlr : avec Gisela Schröter (Cassandre), Robert Massard (Chorèbe), Georg Pappas (Priam), Guy Chauvet (Énée), Jules Bastin (Panthée), Evelyn Lear (Didon), etc.)
JS : Qu'est-ce qui diffère entre la musique de Berlioz de celle des autres ?
JN : Le son. Celui de ses orchestrations est unique. Dans La Damnation de Faust, Berlioz prévoit huit ou dix harpes. C'est inimaginable dans une autre œuvre lyrique. La scène du Victoria Hall est malheureusement trop exiguë pour accepter tous ces musiciens. Il en va ainsi du chœur d'enfants qu'il a fallu supprimer. Berlioz indiquait avec précision l'emplacement des musiciens parce que le son de l'orchestre dépendait de l'écoute apportée par un musicien à son voisin de pupitre. Toujours à cause des dimensions de la scène, il a été impossible d'accéder à cette exigence.
JS : Ne craignez-vous pas que le «son Berlioz» en soit altéré ?
JN : Dirigeant cette musique couramment, j'en ai le son dans l'oreille. Je dose donc les pupitres. Certains traits, joués alternativement par les premiers violons et les altos, ne pourront s'apprécier sans la disposition instrumentale requise par Berlioz. Ce sont des points de détails. L'important, c'est la couleur de l'orchestre. Si on l'enlève, c'est Berlioz qui disparaît. Ici, il faudra composer avec ces frustrations, comme certainement les a vécues Berlioz en son temps.
JS : Et la voix dans les œuvres de Berlioz ?
JN : C'est un instrument de l'orchestre. Berlioz n'accompagne pas le chanteur, comme chez Verdi ou Bellini, mais sa musique complète l'action. L'appropriation du caractère des personnages de Berlioz passe par une parfaite connaissance de la langue française. L'école de chant français n'existant plus, il faut se contenter de voix plutôt que d'interprètes. Dans ses opéras, Faust, Roméo et Juliette, Didon des Troyens, Béatrice et Bénédict sont des personnages de feu. Intimement liés au compositeur, ils sont son miroir. A son tour, le chanteur doit être le miroir de Berlioz. On ne chante pas Berlioz comme on chante des lieder de Schubert.
Propos recueillis par Jacques Schmitt pour le journal «Le Nouveau Quotidien» de Lausanne (article paru partiellement le 10 février 1998 sous le titre : « La Damnation de Faust et de John Nelson »)