Plus de détails
Paris. Grande Salle Pierre-Boulez de la Philharmonie de Paris. 04-IV-2025, 20h. Richard Wagner (1813-1883) : Siegfried (1876). Thomas Blondelle (Siegfried), ténor ; Christian Elsner (Mime), ténor ; Derek Welton (Der Wanderer), baryton-basse ; Daniel Schmutzhard (Alberich), baryton ; Hanno Müller-Brachmann (Fafner), baryton-basse ; Gerhild Romberger (Erda), contralto ; Åsa Jäger (Brünnhilde), soprano ; soliste du Tölzer Knabenchor (Waldvogel), soprano colorature. Dresdner Festspielorchester, Concerto Köln,, direction : Kent Nagano
Le public parisien a eu la chance d'applaudir en version de concert un Siegfried rénové après plusieurs années de recherche musicologique visant à en offrir une lecture historiquement informée. De Dresde à Paris : une quête des origines aboutie !

La sobriété et la clarté seraient peut-être le résultat tangible du projet interdisciplinaire mené sur la base des travaux du musicologue Kai Hinrich Müller et sa relecture des écrits de Wagner. Ce retour aux sources était souhaité par le directeur du Festival de Dresde et violoncelliste Jan Vogler, qui demanda à Kent Nagano de le mener à bien, en collaboration avec le Dresdner Festspielorchester et le Concerto Köln, présents ce soir. Dépoussiérer Wagner revient à revenir à ses propres souhaits : la discrétion d'un orchestre ne nuisant pas à l'intelligilité du texte, l'emploi de certains instruments comme les Tuben, l'usage très modéré du vibrato, ou encore une action continue et en même temps pluridirectionnelle, ce qui suppose l'abandon des répétitions et des airs refermés sur eux-mêmes comme des totalités.
Ce Siegfried annoncé comme modernisé après un siècle et demi d'interprétation, se traduit tout d'abord par le renouvellement de la distribution et son rajeunissement. Ainsi du rôle-titre, tenu par Thomas Blondelle, très investi dans son personnage – d'aucuns penseront qu'il en fait trop –, qu'il dédramatise en forçant un peu son côté ado survitaminé et en jouant aussi sur les aspects comiques de l'œuvre. Sont très peu associés à l'image de Wagner les éléments légers de la comédie, existants pourtant dans ses opéras, ce qui est manifeste à l'acte II, lorsque Siegfried commence par vouloir amadouer l'oiseau par son pipeau, scène très plaisamment rendu ce soir par le hautboïste ne tirant que des canards de son instrument. On relève aussi l'exultation insouciante de Siegfried lorsqu'il reforge Notung et provoque les mimiques drolatiques de Mime (le ténor Christian Elsner, à l'épatant jeu scénique et à la voix moins puissante que celle de Blondelle, ce qui convient bien à son personnage fourbe, identifié comme le juif « aux grandes oreilles » [sic] dont se méfie instinctivement le « garçon aux yeux clairs » qu'est Siegfried), sa naïveté éclatante de béjaune qui veut à tout prix apprendre ce qu'est la peur, auprès de Mime mais aussi du dragon ; ou encore sa complicité avec l'oiseau, lequel, voletant, se heurte physiquement au Voyageur, qui le chasse comme on chasse une mouche. Il y a quelque chose du Joker déluré qu'incarne Jack Nicholson dans le Batman de Tim Burton (1989), avec ce même regard perçant, écarquillé ou par en dessous, ainsi que ce perpétuel sourire équivoque et provocateur d'homme affamé, langue sortie comme pour une invite sexuelle. Un Siegfried qui a échangé sa défroque de jeune homme des bois contre un blouson et un pantalon en jean gris de gamin des banlieues. Ce côté monolithique est à peine entamé par le monologue, à l'acte II, où il pense à ses parents et se questionne sur sa propre responsabilité dans la mort de sa mère à l'accouchement : on n'y croit pas trop. D'une manière générale, la voix bien timbrée de Blondelle et sa projection prodigieuse épousent parfaitement sa qualité de superhéros ignorant la peur et l'envie.
Deux autres interprétations au moins donnent un coup de jeune à la pièce : le Voyageur, incarné par le baryton-basse Derek Welton et Brünnhilde par Åsa Jäger. Très présent le premier, très attendue la seconde ! Le premier incarne parfaitement un Wotan menacé par le crépuscule des dieux. Le chanteur joue à merveille ce dieu fragilisé qui essaie de sauver les apparences, mais dont la lance, pourtant taillée dans un frêne sacré et symbole de son pouvoir, semble une allumette sous le coup de Notung. La robustesse et la couleur de la voix de cet interprète donnent à chacune de ses répliques une intensité dramatique particulière. C'est nuancé et cela sonne juste. Åsa Jäger est tout simplement magnifique dans son personnage sacrifié puis conquis par l'amour. Arrivée la dernière sur scène, elle parfait le casting de ce soir par la puissance et la souplesse de sa voix, qui traduisent parfaitement les affres de cette guerrière désarmée.
Ce rajeunissement, qui passe par le travail sur la diction et l'utilisation d'instruments anciens, met très bien en évidence la nette progression de ce « mouvement ascendant » qu'est Siegfried (André Boucourechliev), où l'on passe des ténèbres des deux premiers actes à la lumière du troisième avec sa rupture stylistique (lumière et légèreté symbolisées par l'oiseau des bois, superbement rendues par la voix cristalline de soprano colorature du soliste du Tölzer Knabenchor). C'est l'« immédiateté du drame » recherchée par Jan Vogler, qui avait été touché par les opéras de Mozart revus par Nikolaus Harnoncourt. Car il s'agit bien d'un drame musical : il n'y a pas de chœur – ou alors c'est l'orchestre qui remplace le chœur antique – et ce ne sont que dialogues et monologues dans un sorte d'arioso ménageant des passages instrumentaux presque chambristes. Ce qui est par-dessus tout délectable est la perspective ou la profondeur entre le devant de la scène occupé par les chanteurs et les instrumentistes qui jouent à l'unisson de la mélodie entonnée, l'annoncent dans un jeu de leitmotivs ou la commentent. Et c'est tout l'art d'un chef comme Kent Nagano de faire avancer l'action tout en ménageant la différenciation entre tous ces plans sonores. Les deux formations, le Dresdner Festspielorchester et le Concerto Köln, le suivent avec la fidélité de phalanges rompues à l'exercice et surtout connaisseuses du répertoire. De là aussi la grande présence de caractères secondaires comme la superbe contralto Gerhild Romberger, très touchante Erda, le baryton Daniel Schmutzhard, expressif Alberich, et le baryton-basse Hanno Müller-Brachmann incarnant Fafner devenu dragon, qui commence par remplir la salle de sa voix caverneuse au sens propre puisqu'amplifiée par une sorte de grand entonnoir de cuivre.
En résumé, nous avons entendu ce soir un Wagner jeune, subtil et léger, bref un Wagner tel qu'en lui-même !
Crédits photographiques : Kent Nagano © Antoine Saito
Plus de détails
Paris. Grande Salle Pierre-Boulez de la Philharmonie de Paris. 04-IV-2025, 20h. Richard Wagner (1813-1883) : Siegfried (1876). Thomas Blondelle (Siegfried), ténor ; Christian Elsner (Mime), ténor ; Derek Welton (Der Wanderer), baryton-basse ; Daniel Schmutzhard (Alberich), baryton ; Hanno Müller-Brachmann (Fafner), baryton-basse ; Gerhild Romberger (Erda), contralto ; Åsa Jäger (Brünnhilde), soprano ; soliste du Tölzer Knabenchor (Waldvogel), soprano colorature. Dresdner Festspielorchester, Concerto Köln,, direction : Kent Nagano





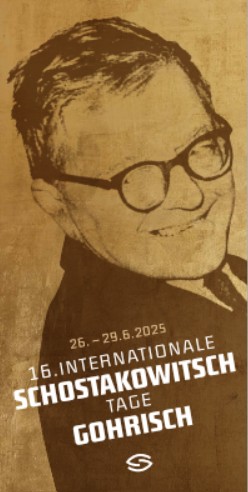


Superbe soirée à tous égards !
L’investissement et le jeu des chanteurs était tel que l’on se passait aisément de mise en scène.
Et quel plaisir d’entendre des interprètes (Christian Elsner tout particulièrement) à la diction impeccable, ce qui était loin d’être le cas à Bastille dans l’Or du Rhin et au TCE dans la Walkyrie de l’an dernier.
Bravo aussi au jeune Félix Hofbauer, apparemment une des stars du Tölzer Knabenchor, qui a magnifiquement interprété le rôle de l’Oiseau des bois.
On ne peut que regretter que le quatrième volet du Ring ne soit pas donné l’an prochain à Paris.