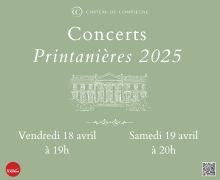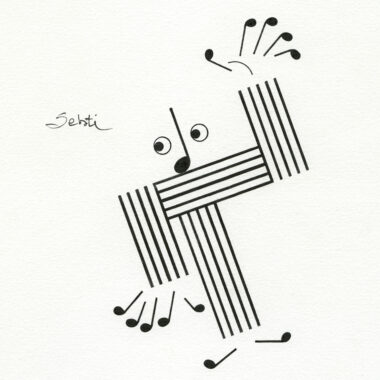Plus de détails
Lyon. Opéra. 29-III-2025. Giorgio Battistelli (né en 1953) : 7 Minuti (7 Minutes), opéra en trois tableaux sur un livret du compositeur, d’après la pièce homonyme de Stefano Massini. Mise en scène : Pauline Bayle. Scénographie : Lisetta Buccellato. Costumes : Pétronille Salomé. Lumières : Mathilde Chamoux. Chorégraphie : Agnès Butet. Vidéo : Pierre Martin Oriol. Avec : Natascha Petrinsky, contralto (Blanche) ; Jenny Daviet, soprano (Mireille) ; Sohia Burgos, soprano (Sabine) ; Nicola Beller Carbone, soprano (Odette) ; Shakèd Bar, mezzo-soprano (Rachel) ; Giulia Scopelliti, soprano (Agnieska) ; Anne-Marie Stanley, mezzo-soprano (Mahtab) ; Eva Langeland Gjerde, soprano (Zoélie) ; Jenny Anne Flory, mezzo-soprano (Arielle) ; Elisabeth Boudreault, soprano (Sophie) ; Lara Lagni, soprano (Lorraine). Chœur (chef de choeur : Guillaume Rault) et Orchestre de l’Opéra de Lyon, direction musicale : Miguel Pérez Iñesta
Parfaite illustration du nouvel intitulé (Se saisir de l'avenir) du festival printanier de l'Opéra de Lyon, le dernier opéra de Giorgio Battistelli se saisit d'une problématique désolante : la souffrance au travail.
« L'opéra ne doit pas seulement proposer au public un moment de consolation, de divertissement ou de fascination. Il doit aussi faire réfléchir sur ce qui se joue dans le monde d'aujourd'hui », déclarait, en 2019, le compositeur italien à la création de 7 minuti à Nancy. Une déclaration dans le droit sillage des mots visionnaires de son compatriote Pasolini, dont Battistelli a adapté l'emblématique Teorema, film qui était loin de n'être que pur objet de contemplation. Une déclaration pas toujours partagée par tout une frange d'un public continuant de se ruer à l'opéra. À voir la salle de l'Opéra Nouvel aussi remplie pour la dernière lyonnaise de 7 minuti que pour les « squatteuses » Carmen et Traviata, on se dit que les choses sont en train de changer.
Ce qui, en revanche, ne change toujours pas, malgré le Zola de Germinal, malgré la révolte des Canuts, ou, plus proche, le combat des Lip, c'est l'appétence humaine à l'exploitation de l'homme par l'homme. En l'occurrence de la femme par l'homme. 7 minuti se penche sur le combat des employées de l'entreprise Lejaby qui, en 2012, à Yssingeaux furent conviées à empêcher la fermeture de leur usine à la condition qu'elles acceptassent de sacrifier sept minutes de pause ! Au XXIe siècle ! On crut rêver. Mais l'indignation culturelle fut surtout italienne : l'écrivain Stefano Massini éleva cette mini-tragédie au rang de tragédie des temps modernes au moyen d'une pièce de théâtre, le cinéaste Michel Placido d'un film, et Giorgio Battistelli d'un opéra. 7 minuti dénonce le désastre de ce qu'on avait au départ vendu comme « la mondialisation heureuse ».
Ecrasées au pied d'un immense décor bétonné, les tisseuses de l'opéra sont d'emblée au bas de l'échelle sociale, figurée par un grand escalier plongeant dans un atelier sans fenêtres, qu'on croirait attenant à la salle d'expérimentations sur le cobaye Wozzeck en début de saison. Deux souffleries latérales leur envoient en continu, comme si elles voulaient les ensevelir là, une matière à traiter assez inidentifiable, qu'elles transformeront en matelas et même en ballon. Pour l'heure, elles sont à la rampe, occupées à coudre une immense banderole destinée à arborer en étendard la partie supérieure du cadre de scène, et sur laquelle l'ensemble de la représentation rappellera le mot d'ordre: Coudre pour en découdre. Les dix femmes à l'œuvre en attendent une onzième, Blanche, porte-parole occupée à l'étage supérieur à recueillir les conclusions des « cravates », appellation donnée aux décideurs, entrepreneurs et repreneurs de l'entreprise prétendument en difficulté. Son arrivée tardive donne le coup d'envoi d'une discussion en temps réel (deux heures d'horloge : le décompte s'affiche en fond de scène) où, à la manière d'Henry Fonda dans Douze hommes en colère, Blanche s'escrime à faire vaciller les certitudes panurgiennes de ses collègues, prêtes à sacrifier lesdites 7 minutes sans réaliser que, comptabilisées sur un mois, elles en auront fait un cadeau de 600 heures !
Comme le film de Sidney Lumet, 7 minuti est un huis clos. C'est aussi une conversation en musique qui, bien que tentée par les arias et les duos (il y a même un quintette), ou entrecoupée d'intervention chorales entre ses trois tableaux, et bien que tonale, reste austère. Les interludes ne s'attardent pas comme chez Berg ou Poulenc, la partition ne s'autorisant même pas la submersion émotionnelle finale de Wozzeck par exemple, comme on aurait pu s'y attendre. Des battements de la percussion introductifs au pizzicato conclusif, Miguel Pérez Iñesta apporte, de la fosse, un prenant soutien à ce suspense discursif, religieusement suivi par le public. Se déployant sur un tapis orchestral conséquent (dont une armada percussive, un accordéon, un piano), l'écriture vocale est d'un lyrisme tendu, au diapason des échanges entre sopranos (Giulia Scopelitti, Lara Lagni), soprano légère (Jenny Daviet), soprano lyrique (Eva Langeland Gjerde), soprano colorature (Elisabeth Boudreault), soprano dramatique (Sophia Burgos, Nicola Beller Carbone), mezzo-soprano (Jenny Anne Flory, Anne-Marie Stanley), mezzo-soprano dramatique (Shakèd Bar) et contralto (Natasha Petrinsky). Aussi soudée autour de la partition à défendre que les personnages incarnés le sont autour de la décision à prendre, c'est là une distribution exemplaire, pour laquelle on n'a aucune envie de jouer les « cravates » de la critique.
La mise en scène de Pauline Bayle bat en brèche l'apparent surplace du discours. La jeune metteuse en scène, qui nous avait tant laissés à quai avec l'inconsistance de son Orfeo avec Savall, révèle un tout autre aplomb (image forte des femmes aux lèvres couturées par les points de croix de leurs votes) face à l'urgence de 7 minuti. La direction d'actrices, des plus vives, réussit même à extirper de l'anonymat chacune des onze employées : longuement données à voir en gros plan pendant l'installation du public, elles expriment progressivement leur différence, même celles qui ont le moins à chanter, de la tête de pont Blanche à l'accorte Mireille, de l'Iranienne Mattab à la Polonaise Agnieszka, du couple mère-fille Odette/ Sabine à la discrète Lorraine,… Les échanges, entre attaques personnelles et racisme rampant n'ont rien d'angélique. Pauline Bayle a la très belle idée de chorégraphier certains moments où la voix humaine se tait. Un procédé ingénieux qu'on aurait cependant souhaité voir plus développé.
Visuellement beau, le spectacle se referme sur une image aussi énigmatique que la conclusion du livret : les onze chaises à la rampe desquelles se seront exprimés les trois tours de vote s'enflamment de concert. Une façon de dire que le combat est loin d'être terminé quant à ce sujet toujours inflammable. Ce que semble corroborer, toujours au sommet du dispositif, la banderole-étendard qui, en clôture de la série de six représentations, décide de s'inviter à son tour dans la dramaturgie : se décrochant partiellement, suite à un providentiel incident technique, la voilà in fine privée des mots « en découdre ». Pas sûr dès lors, que, comme l'ouvrière hurlante du film d'Hervé Leroux (Reprise) sur la reprise des usines Wonder, la jeune Sophie, sur les épaules de qui la conclusion de l'opéra repose, n'ait pas envie de clamer à son tour: « Je rentrerai pas là d'dans. Je mettrai plus les pieds dans cette taule. »
Crédits photographiques : © Jean-Louis Fernandez
Plus de détails
Lyon. Opéra. 29-III-2025. Giorgio Battistelli (né en 1953) : 7 Minuti (7 Minutes), opéra en trois tableaux sur un livret du compositeur, d’après la pièce homonyme de Stefano Massini. Mise en scène : Pauline Bayle. Scénographie : Lisetta Buccellato. Costumes : Pétronille Salomé. Lumières : Mathilde Chamoux. Chorégraphie : Agnès Butet. Vidéo : Pierre Martin Oriol. Avec : Natascha Petrinsky, contralto (Blanche) ; Jenny Daviet, soprano (Mireille) ; Sohia Burgos, soprano (Sabine) ; Nicola Beller Carbone, soprano (Odette) ; Shakèd Bar, mezzo-soprano (Rachel) ; Giulia Scopelliti, soprano (Agnieska) ; Anne-Marie Stanley, mezzo-soprano (Mahtab) ; Eva Langeland Gjerde, soprano (Zoélie) ; Jenny Anne Flory, mezzo-soprano (Arielle) ; Elisabeth Boudreault, soprano (Sophie) ; Lara Lagni, soprano (Lorraine). Chœur (chef de choeur : Guillaume Rault) et Orchestre de l’Opéra de Lyon, direction musicale : Miguel Pérez Iñesta