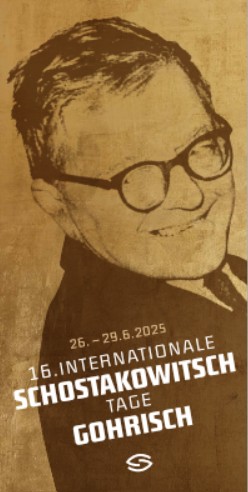Maria de Buenos Aires de Piazzolla en version intégrale à la Cité Bleue : tout pour la musique
Plus de détails
Genève. La Cité Bleue. 6-III-2025. Astor Piazzolla (1921-1992) : María de Buenos Aires, opéra-tango en deux parties sur un livret d’Horacio Ferrer. Mise en espace : Amélie Parias. Avec : Sol García (María/L’Ombre de María) ; Diego Valentín Flores, baryton (Gorrión) ; Sebastián Rossi (Il Duende). Roger, Hélou, piano ; Adrian Fioramonti, guitare ; Mariana Jordan, flûte ; Romain Lecuyer, contrebasse ; Richard Héry, batterie et percussion ; Attilio Terlizzi, percussions-clavier. Quatuor Terpsychordes. Chœur : Natalia Almada, Joaquín Martínez, Osvaldo Calo, Mariana Bustelo, Sol Bustelo, Seba Sirro. Direction artistique et bandonéon : William Sabatier
Evènement à Genève, où le bandéoniste William Sabatier entend rendre à María de Buenos Aires ce qui appartenait dès le départ à l'operita d'Astor Piazzolla et d'Horacio Ferrer, dont l'intégrité musicale se vit en son temps contrainte par l'industrie discographique.
 Lorsqu'il s'agit de fixer au disque le succès qui, de mai à septembre 1968, accueillit les 120 représentations de María de Buenos Aires à la Sala Planeta, au cœur de la capitale argentine, il apparut que la durée de l'œuvre excédait les limites d'un double album 33 tours. Le compositeur dut alors faire le deuil de deux numéros de la première partie, l'un chanté, La Fábula de la rosa en el asfalto (la Fable de la rose sur l'asphalte), l'autre purement orchestral, un scherzo intitulé Esquerzo yumba de las tres de la mañana.
Lorsqu'il s'agit de fixer au disque le succès qui, de mai à septembre 1968, accueillit les 120 représentations de María de Buenos Aires à la Sala Planeta, au cœur de la capitale argentine, il apparut que la durée de l'œuvre excédait les limites d'un double album 33 tours. Le compositeur dut alors faire le deuil de deux numéros de la première partie, l'un chanté, La Fábula de la rosa en el asfalto (la Fable de la rose sur l'asphalte), l'autre purement orchestral, un scherzo intitulé Esquerzo yumba de las tres de la mañana.
C'est à cette version originale jamais ré-entendue par la suite que William Sabatier entend revenir presque un demi-siècle plus tard, effectif orchestral de la création (onze instrumentistes) à l'appui. Une exécution palpitante, contrairement à la version entendue au Grand théâtre de Genève en 2023 mise en scène par Daniele Finzi Pasca, qui n'est pas sans faire vaciller jusqu'aux certitudes consécutives au splendide enregistrement Nonesuch dans lequel Gidon Kremer avait demandé au compositeur Leonid Desyatnikov d'arranger la partition pour huit instrumentistes, version qui n'est pas loin d'apparaître un brin policée tant ce qu'il convient de nommer dorénavant la version Sabatier, diablement plus rugueuse, charrie de fièvre et d'urgence autour de l'ardeur jusqu'au-boutiste de son bandonéon. Quasi désespérée, donnant une belle belle place à la flûte, à la guitare électrique, au quatuor à cordes (l'excellent Quatuor Terpsychordes), elle emporte l'adhésion de bout en bout.
 Sur l'idéal de ce tapis sonore, rehaussé de transitions enregistrées qui font entendre les voix de la métropole argentine, d'un chœur invisibilisé, mais aussi celles d'Astor Piazzolla et d'Horacio Ferrer, se posent les interventions d'un merveilleux trio vocal. Silhouette gracieuse griffée de longues robes soyeuses, l'Argentine Sol García voile d'une mélancolie idoine un timbre qui ressuscite d'entre les morts une héroïne vue par le librettiste, non seulement comme un personnage à part entière (une manière de diva des faubourgs) mais aussi comme l'âme même du tango. À la fin, lorsqu'après sa disparition elle renaît sous la forme de sa propre fille nommée elle aussi María, elle est fêtée comme au final du film de Jacques Audiard, Emilia Pérez, elle est devenue l'âme d'une ville, et même d'un pays tout entier. Lui aussi enfant de ce pays, Diego Valentín Flores, frère d'une autre « María » (Mariana Flores), crédité dans le seul rôle de Gorrión, assure de fait tous les rôles masculins. De sa première intervention (la sublime Milonga carrieguera por María la Niña) jusqu'à l'ultime, il apporte le plus émouvant des contrepoints chantés au superbe Duende parlé (l'Esprit narrateur) du Patagonien Sebastián Rossi. Une fine sonorisation pour tous achève de conférer une prégnante proximité à cette œuvre entre opéra et cabaret.
Sur l'idéal de ce tapis sonore, rehaussé de transitions enregistrées qui font entendre les voix de la métropole argentine, d'un chœur invisibilisé, mais aussi celles d'Astor Piazzolla et d'Horacio Ferrer, se posent les interventions d'un merveilleux trio vocal. Silhouette gracieuse griffée de longues robes soyeuses, l'Argentine Sol García voile d'une mélancolie idoine un timbre qui ressuscite d'entre les morts une héroïne vue par le librettiste, non seulement comme un personnage à part entière (une manière de diva des faubourgs) mais aussi comme l'âme même du tango. À la fin, lorsqu'après sa disparition elle renaît sous la forme de sa propre fille nommée elle aussi María, elle est fêtée comme au final du film de Jacques Audiard, Emilia Pérez, elle est devenue l'âme d'une ville, et même d'un pays tout entier. Lui aussi enfant de ce pays, Diego Valentín Flores, frère d'une autre « María » (Mariana Flores), crédité dans le seul rôle de Gorrión, assure de fait tous les rôles masculins. De sa première intervention (la sublime Milonga carrieguera por María la Niña) jusqu'à l'ultime, il apporte le plus émouvant des contrepoints chantés au superbe Duende parlé (l'Esprit narrateur) du Patagonien Sebastián Rossi. Une fine sonorisation pour tous achève de conférer une prégnante proximité à cette œuvre entre opéra et cabaret.
Cet enthousiasmant retour musical (jusque dans ses trois bis piazzollesques : une reprise décontractée de Yo soy María par Sol García, Chiquilín de Bachín par Diego Valentín Flores, la Ultima Grela par Sebastian Rossi) voit son envol sérieusement compromis par la censure de tout surtitrage. « Ce qui est le plus important dans l'œuvre de Ferrer, est persuadé Sabatier, c'est l'élocution », « Le texte de Ferrer représente une part de plus dans l'orchestration de Piazzolla ». Sur le papier on souscrit à cette ambition folle de l'abandon non seulement à la beauté d'une musique envoûtante mais également à la seule musicalité de la prose surréaliste et rendue hermétique par son conséquent recours au lunfardo (l'argot vernaculaire de Buenos Aires) du poète-librettiste Horacio Ferrer. Mais sur le plateau c'est toute une autre histoire. Car c'est à la partie scénique que William Sabatier a souhaité déléguer le soin de surtitrer l'operita. C'est évidemment trop demander à la mise en espace d'Amélie Parias : l'effectif orchestral occupe la quasi-entièreté du plateau, ne laissant à la scénographie que de bien chiches espaces (rue passante en fond de scène devant un tulle nimbé de bleu, de gris, de rouge, avant-scène occupé à jardin par deux tables de bistrot), et à la direction d'acteurs que la perspective de lentes errances spectrales.
 On ne peut que constater comment la crainte de perdre son spectateur a pu conduire William Sabatier à le perdre pour de bon : après avoir cru longtemps à un problème technique, celui-ci finit par réaliser qu'il est lui aussi condamné, comme l'héroïne, à errer deux heures durant dans les arcanes d'une œuvre labyrinthique. María de Buenos Aires est certes davantage une évocation qu'un modèle narratif, mais pas un mot auquel se raccrocher, pas même la moindre piste vidéographiée. En privant son public de tout repère dramaturgique, Sabatier donne même le sentiment, ce qui est peut-être le plus regrettable, de bâillonner l'œuvre en oubliant qu'un opéra (même humblement qualifié d'operita) c'est un spectacle total, le livret n'en étant pas la moindre composante. Si Astor Piazzolla sort indemne de la soirée (acclamations ferventes pour la première de trois représentations affichant complet), quid d'Horacio Ferrer dont la prose paraît comme punie ? « J'estime qu'il est important que le public comprenne ce qui se passe sur scène », avait pourtant aussi déclaré William Sabatier. Une profession de foi au final quasi schizophrénique tant, contrairement à la récente (et séduisante) version lyonnaise, l'impénétrabilité de cette María de Buenos Aires genevoise, qui, munie de ses mirifiques atouts musicaux, avait tout pour faire monter d'un cran la ferveur ascendante de l'œuvre, s'avère, en l'état, presque contre-productive.
On ne peut que constater comment la crainte de perdre son spectateur a pu conduire William Sabatier à le perdre pour de bon : après avoir cru longtemps à un problème technique, celui-ci finit par réaliser qu'il est lui aussi condamné, comme l'héroïne, à errer deux heures durant dans les arcanes d'une œuvre labyrinthique. María de Buenos Aires est certes davantage une évocation qu'un modèle narratif, mais pas un mot auquel se raccrocher, pas même la moindre piste vidéographiée. En privant son public de tout repère dramaturgique, Sabatier donne même le sentiment, ce qui est peut-être le plus regrettable, de bâillonner l'œuvre en oubliant qu'un opéra (même humblement qualifié d'operita) c'est un spectacle total, le livret n'en étant pas la moindre composante. Si Astor Piazzolla sort indemne de la soirée (acclamations ferventes pour la première de trois représentations affichant complet), quid d'Horacio Ferrer dont la prose paraît comme punie ? « J'estime qu'il est important que le public comprenne ce qui se passe sur scène », avait pourtant aussi déclaré William Sabatier. Une profession de foi au final quasi schizophrénique tant, contrairement à la récente (et séduisante) version lyonnaise, l'impénétrabilité de cette María de Buenos Aires genevoise, qui, munie de ses mirifiques atouts musicaux, avait tout pour faire monter d'un cran la ferveur ascendante de l'œuvre, s'avère, en l'état, presque contre-productive.
Crédits photographiques : © Giulia Charbit- La Cité Bleue
Plus de détails
Genève. La Cité Bleue. 6-III-2025. Astor Piazzolla (1921-1992) : María de Buenos Aires, opéra-tango en deux parties sur un livret d’Horacio Ferrer. Mise en espace : Amélie Parias. Avec : Sol García (María/L’Ombre de María) ; Diego Valentín Flores, baryton (Gorrión) ; Sebastián Rossi (Il Duende). Roger, Hélou, piano ; Adrian Fioramonti, guitare ; Mariana Jordan, flûte ; Romain Lecuyer, contrebasse ; Richard Héry, batterie et percussion ; Attilio Terlizzi, percussions-clavier. Quatuor Terpsychordes. Chœur : Natalia Almada, Joaquín Martínez, Osvaldo Calo, Mariana Bustelo, Sol Bustelo, Seba Sirro. Direction artistique et bandonéon : William Sabatier