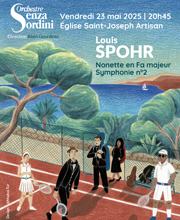Plus de détails
Paris. Théâtre des Champs-Élysées. 13-II-2025. Georg Friedrich Haendel (1685-1759) : Semele, oratorio en trois actes sur un livret de William Congreve. Mise en scène : Oliver Mears. Scénographie et costumes : Annemarie Woods. Lumières : Fabiana Piccioli. Chorégraphie : Sarah Fahie. Avec : Pretty Yende, soprano (Semele) ; Ben Bliss, ténor (Jupiter) ; Carlo Vistoli, contre-ténor (Athamas) ; Alice Coote, mezzo-soprano (Junon) ; Niamh O’Sullivan, mezzo-soprano (Ino) ; Marianna Hovanisyan, soprano (Iris) ; Brindley Sherratt (Cadmus/Somnus). Chœur (chef de chœur : Richard Wilberforce) et Orchestre Le Concert d’Astrée, direction : Emmanuelle Haïm
Dans la mise en scène d'Olivier Mears, Jupiter se met à nu pour s'exposer dans le simple appareil d'un tueur en série.
Pour parler à une époque qui avait vent des infidélités du Roi George II, William Congreve, le librettiste de Haendel, remonte à celles de Jupiter, dont les Métamorphoses d'Ovide ont décrit par le menu les frasques tortueuses. Capable, pour arriver à ses fins, de se transformer en cygne, en taureau, en pluie d'or, c'est sous la forme d'un aigle que l'immortel qu'il est enlève la mortelle qu'est Semele à un avenir qui la destinait à épouser le bel Athamas, lui-même convoité par la blonde Ino. Semele, éblouie par son statut d'élue des dieux, découvrira progressivement l'envers de l'enveloppe mortelle de son prestigieux amant. Après avoir tenté en vain de militer pour l'égalité homme-femme en amour (ici immortalité pour tous), elle finira calcinée au terme d'une vengeance ourdie par Juno, l'épouse délaissée du volage bellâtre. Toujours d'actualité, ces problématiques ont légitimement autorisé Oliver Mears, l'actuel directeur de Covent Garden où le spectacle sera programmé en fin de saison, à délaisser l'Arcadie du livret pour celle du quotidien doré des magnats d'aujourd'hui.
Lorsque se lève le rideau de scène spécifique (une inquiétante grille charbonneuse) conçu pour cette nouvelle Semele, on devine immédiatement que sa reproduction miniaturisée sur l'immense cheminée qui trône au centre du salon imposant et glacial dessiné par Annemarie Woods indique que l'âtre sera le point autour duquel, comme le mobilier, tournera toute l'intrigue. Les baies vitrées, qui ne s'ouvriront qu'à l'Acte II sur un sombre ciel étoilé, restent closes et l'on comprendra peu à peu le pourquoi d'un tel confinement. En attendant la révélation des turpitudes du maître de céans, Oliver Mears révèle d'emblée son habileté à exposer la galaxie relationnelle d'un livret a priori plutôt complexe. Il fait de Semele un des pions d'une domesticité aux ordres : la première image la montre en Cendrillon des temps modernes attachée à recueillir dans l'âtre des cendres que Jupiter et son homme de main enferment aussitôt dans une urne funéraire. Ce n'est qu'à la fin de la soirée que le spectateur comprendra que la cendre qu'elle ramasse avant les premières notes de musique n'est pas celle de quelque « bûche », mais plutôt celle de quelque victime du « petit personnel ». Landru, Petiot, Jupiter même combat ! Car on ne rigole pas avec la lutte des classes chez les Jupiter, sauf d'un rire jaune : à la fin seulement, lorsque tout est consommé, on se souvient que, dès le début, le maître des lieux avait demandé à l'architecte du palais de rajouter sur le plan une cheminée avec fumerole de sinistre augure. Entre-temps l'amant irrésistible aura accouché d'un parrain terrifiant, éliminant ses opposants (pauvre Athamas, dont les yeux s'étaient peu à peu dessillés), à seule fin de ne pas interrompre le jeu infernal du sexe et de la mort.
 Emmanuelle Haïm, familière d'une œuvre qu'elle avait déjà jouée à Lille en contrepoint de la mise en scène de Barrie Kosky, dirige un Concert d'Astrée que l'on a rarement entendu produire des sons aussi mélancoliques. Le primat donné aux cordes produit une atmosphère de lamento parfaitement accordé à la pompe funèbre d'une cérémonie de moins en moins secrète. En victime de la mode aveuglée par le luxe, Pretty Yende fait joliment son entrée dans le monde baroque avec des vocalises aisées et un legato aérien du plus bel effet. Après son éclatante prestation dans The Rake's Progress, Ben Bliss confirme sa belle vocalité en faisant montre notamment de l'impressionnante capacité de gestion d'un registre aigu ici exigeant. Alice Coote, Junon pleine d'expérience au timbre un peu rugueux, fait taire toute réserve, colorant à l'envi ses interventions d'un machisme vocal qui rappelle que, comme la Fricka wagnérienne, c'est bien elle qui tire les ficelles. L'élégance qualifie la prestation de Carlo Vistoli, Athamas aux ornements ciselés. Moins connues, mais tout aussi remarquablement distribuées, s'imposent l'Iris de Marianna Hovanisyan et l'Ino de Niamh O'Sullivan, particulièrement regardée par la mise en scène. Brindley Sherratt offre le charbon de son timbre aujourd'hui si familier à un Somnus bien aviné et à un Cadmus qui, en charge également des interventions du Prêtre, endosse la casquette de Majordome. Mears mixe de même Iris avec Cupidon et, pour la présentation finale du bébé de Semele (Dionysos), Jupiter avec Apollon. Clonés en tenue lie-de-vin, les membres du chœur Le Concert d'Astrée incarnent avec une formidable présence la majorité silencieuse dont le silence et l'impuissance paraphent la cérémonie secrète à laquelle se livre à nouveau leur riche employeur.
Emmanuelle Haïm, familière d'une œuvre qu'elle avait déjà jouée à Lille en contrepoint de la mise en scène de Barrie Kosky, dirige un Concert d'Astrée que l'on a rarement entendu produire des sons aussi mélancoliques. Le primat donné aux cordes produit une atmosphère de lamento parfaitement accordé à la pompe funèbre d'une cérémonie de moins en moins secrète. En victime de la mode aveuglée par le luxe, Pretty Yende fait joliment son entrée dans le monde baroque avec des vocalises aisées et un legato aérien du plus bel effet. Après son éclatante prestation dans The Rake's Progress, Ben Bliss confirme sa belle vocalité en faisant montre notamment de l'impressionnante capacité de gestion d'un registre aigu ici exigeant. Alice Coote, Junon pleine d'expérience au timbre un peu rugueux, fait taire toute réserve, colorant à l'envi ses interventions d'un machisme vocal qui rappelle que, comme la Fricka wagnérienne, c'est bien elle qui tire les ficelles. L'élégance qualifie la prestation de Carlo Vistoli, Athamas aux ornements ciselés. Moins connues, mais tout aussi remarquablement distribuées, s'imposent l'Iris de Marianna Hovanisyan et l'Ino de Niamh O'Sullivan, particulièrement regardée par la mise en scène. Brindley Sherratt offre le charbon de son timbre aujourd'hui si familier à un Somnus bien aviné et à un Cadmus qui, en charge également des interventions du Prêtre, endosse la casquette de Majordome. Mears mixe de même Iris avec Cupidon et, pour la présentation finale du bébé de Semele (Dionysos), Jupiter avec Apollon. Clonés en tenue lie-de-vin, les membres du chœur Le Concert d'Astrée incarnent avec une formidable présence la majorité silencieuse dont le silence et l'impuissance paraphent la cérémonie secrète à laquelle se livre à nouveau leur riche employeur.
Parfois surjouée par une direction d'acteurs moins fluide que celle d'un Carsen, la pompe funèbre d'Oliver Mears, malgré quelques maladresses (le sous-emploi des trois enfants -progéniture adultérine de l'infidèle ? -, la scène du réveil d'un Somnus en caleçon et fixe-chaussettes aviné dans une salle de bains envahie de cadavres de bouteilles, émoustillé par la caricaturale pantomime de Pasithéa, ou encore la longue scène d'amour Semele/Jupiter sous les draps et, on suppose, sous le regard d'une coordinatrice d'intimité), emporte le morceau avec le coup asséné par sa scène finale : tandis que les derniers numéros haendéliens butinent allègrement de « wonder » en « happy » de « pleasures » en « love », s'enchaînent, aussi réfrigérantes que nécessaires, des images qui rappellent le destin de la pauvre Semele, et prédisent déjà celui-là même qui attend la nouvelle domestique tout juste débarquée pour remplacer l'héroïne, poussée au suicide par sa passion pour celui qu'elle croyait être un « dieu ».
Jusqu'à ce jour considéré comme « un opéra mythologique italien déguisé en oratorio anglais » et « une apologie de l'humilité et de la vertu conjugale » (Jean-Louis Martinoty), Semele est donc bien davantage que cela. Ceux qui étaient venus écouter sa musique qualifiée de « ravissante » (donc un cran en dessous de l'inspiration plus fertile en tubes d'Alcina et Giulio Cesare) quittent le TCE en se disant qu'ils ont enfin découvert, tel un secret longtemps caché, la vérité quant à la dramaturgie de Semele, à l'évidence une des plus terribles qui soient. Une nouvelle preuve qu'une mise en scène d'opéra est un luxe nécessaire.
Crédits photographiques : © Vincent Pontet
Plus de détails
Paris. Théâtre des Champs-Élysées. 13-II-2025. Georg Friedrich Haendel (1685-1759) : Semele, oratorio en trois actes sur un livret de William Congreve. Mise en scène : Oliver Mears. Scénographie et costumes : Annemarie Woods. Lumières : Fabiana Piccioli. Chorégraphie : Sarah Fahie. Avec : Pretty Yende, soprano (Semele) ; Ben Bliss, ténor (Jupiter) ; Carlo Vistoli, contre-ténor (Athamas) ; Alice Coote, mezzo-soprano (Junon) ; Niamh O’Sullivan, mezzo-soprano (Ino) ; Marianna Hovanisyan, soprano (Iris) ; Brindley Sherratt (Cadmus/Somnus). Chœur (chef de chœur : Richard Wilberforce) et Orchestre Le Concert d’Astrée, direction : Emmanuelle Haïm