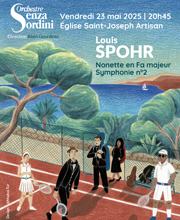De Brahms à Rihm, tout un univers poétique pour Christian Gerhaher et Tabea Zimmermann
Plus de détails
Luxembourg. Philharmonie, Salle de musique de chambre. 10-II-2025. Johannes Brahms (1833–1897) : Regenlied-Zyklus (cycle de chansons de la pluie) ; Wolfgang Rihm (1952–2024) : Stabat Mater pour baryton et alto ; Robert Fuchs (1847–1927) : Sechs Phantasiestücke pour alto et piano op. 117 ; Wolfgang Rihm : Harzreise im Winter, pour baryton et piano ; György Kurtág (né en 1926) : Signs, Games and Messages (extraits) ; Othmar Schoeck (1886–1957) : Lieder sur des poèmes de Nikolaus Lenau ; Johannes Brahms : Zwei Gesänge op. 91. Christian Gerhaher, baryton ; Tabea Zimmermann, alto ; Gerold Huber, piano.
Dans l'admirable Salle de musique de chambre de Luxembourg, avec le piano de Gerold Huber, un programme dense et une intensité de presque tous les instants.

Déjà la lecture du programme ouvrait l'appétit du mélomane curieux : un Liederabend de Christian Gerhaher et Gerold Huber, certes, mais avec une originalité et une ambition folle – littéraire, conceptuelle, et bien sûr musicale -, et avec une partenaire de choix en la personne de Tabea Zimmermann. La figure de Brahms, qui ouvre et ferme le concert, est certes omniprésente, avec son protégé Robert Fuchs, mais aussi avec un texte de Goethe mis en musique par Wolfgang Rihm, Harzreise im Winter (Voyage dans le Harz en hiver), long poème dans lequel Brahms a puisé le texte de sa Rhapsodie pour alto.
La première œuvre, Cycle de la pluie composée par Brahms avant d'être dissous dans l'op. 59, n'est pas celle qui convient le mieux à Christian Gerhaher, qui se laisse aller à une extériorisation opératique pas très bien venue, et peu représentative de son art. La suite du concert, heureusement, le ramène à ce qui fait sa force. L'un des intérêts majeurs du programme réside dans les deux œuvres de Wolfgang Rihm, le Stabat mater pour alto et baryton et Harzreise im Winter, pour piano et baryton, toutes deux créées (en 2020 et en 2012) par les mêmes interprètes. Les deux pièces ont en commun leur grande expressivité, qui dépasse largement le cadre le plus intime du lied, représenté ce soir par quelques Lieder d'Othmar Schoeck ; la tragédie mariale du Stabat comme celle de l'homme perdu dans la sauvage nature sont au contraire de grandes scènes où Rihm n'a pas peur d'extérioriser les émotions, au plus près du texte : 60 vers pour l'un, 88 vers pour l'autre, en un petit quart d'heure chaque, le texte va vite, mais la composition en traque les moindres détails, et il faut des interprètes aussi scrupuleux que leurs dédicataires pour suivre cette exigence au mot et à la note près.

Les pièces de Robert Fuchs que Tabea Zimmermann interprète avec Gerold Huber n'atteignent pas les mêmes sommets : dernière œuvre du compositeur écrite l'année de sa mort (1927), elles valent surtout comme ultime tentative d'évoquer le monde disparu du romantisme germanique, et même l'engagement de l'interprète ne parvient pas à donner un peu de consistance à cette nostalgie – la grandeur de l'alto de Zimmermann est beaucoup plus visible dans les trois pièces de Kurtág pour lesquelles elle est seule en scène. Les Lieder de Schoeck, eux aussi, semblent à l'écart de leur temps – Schoeck est né près de 40 ans après Fuchs, mais ces Lieder datent de 1921/1922 ; composés pour piano et voix, ils sont un peu plus connus sous leur forme orchestrale, intégrés dans le cycle Elegie op. 36 que Gerhaher a enregistré avec Heinz Holliger. Que Schoeck soit à l'écart des novations musicales de son temps n'est cette fois pas un problème : la rencontre de son art du mot pudique et précis avec la voix de Gerhaher en ses suprêmes allègements, avec le piano réduit à l'essentiel de Gerold Huber est un vrai miracle, que le contraste avec les grands épanchements de Rihm rend encore plus frappant.
La dernière œuvre du programme vient conclure une autre ligne dramaturgique de la soirée, qui justifie le titre un peu abscons donné au concert (Mutterherzen: still & zerrissen, soit à peu près Cœurs maternels : silencieux et déchiré) : la berceuse mariale du deuxième Lied de l'op. 91 de Brahms répond ainsi au Stabat mater de la première partie. L'alto généreux de Tabea Zimmermann, la pudeur de Gerhaher, le piano discret et disert de Huber, dans la meilleure salle qui soit pour la musique de chambre: on peut difficilement imaginer moment musical plus riche que ces deux heures exigeantes et gratifiantes.
Crédits photographiques : © Philharmonie Luxembourg / Sébastien Grebille
Plus de détails
Luxembourg. Philharmonie, Salle de musique de chambre. 10-II-2025. Johannes Brahms (1833–1897) : Regenlied-Zyklus (cycle de chansons de la pluie) ; Wolfgang Rihm (1952–2024) : Stabat Mater pour baryton et alto ; Robert Fuchs (1847–1927) : Sechs Phantasiestücke pour alto et piano op. 117 ; Wolfgang Rihm : Harzreise im Winter, pour baryton et piano ; György Kurtág (né en 1926) : Signs, Games and Messages (extraits) ; Othmar Schoeck (1886–1957) : Lieder sur des poèmes de Nikolaus Lenau ; Johannes Brahms : Zwei Gesänge op. 91. Christian Gerhaher, baryton ; Tabea Zimmermann, alto ; Gerold Huber, piano.