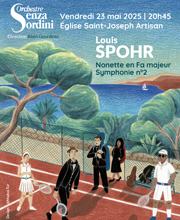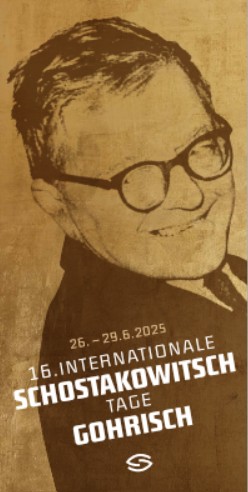Plus de détails
Paris. Théâtre du Châtelet. 23-I-2025. Georg Friedrich Haendel (1685-1759) : Orlando, opéra en trois actes ; livret d’un auteur anonyme, inspiré de Carlo Sigismondo Capece, de Grazio Braccioli et de l’Orlando furioso de l’Arioste ; mise en scène : Jeanne Desoubeaux ; scénographie : Cécile Trémolières ; costumes : Alex Costantino ; lumières : Thomas Coux dit Castille ; chorégraphie : Rodolphe Fouillot. Katarina Bradić, mezzo-soprano, Orlando ; Siobhan Stagg, soprano, Angelica ; Elisabeth DeShong, mezzo-soprano, Medoro ; Giulia Semenzato, soprano, Dorinda ; Riccardo Novaro, baryton basse, Zoroastro ; Nour Brunhes Esturgie, Adèle Moreau Penin, Orlando enfant ; Melina Masungi, Antoine Bouaziz, Angelica enfant ; Esteban Hernandez Sanchez, Ethan Darsoulant, Medoro enfant ; Daniel Hernandez Sanchez, Jasmine Sadouni Baghouli, Dorinda enfant. Figuration : élèves du Conservatoire Edgard Varèse/Conservatoire de Gennevilliers ; élèves du Conservatoire Ida Rubinstein/CRR ; Les Talens lyriques, direction : Christophe Rousset
Créé à Londres en 1733, l'Orlando de Haendel, un des plus grands opéras seria du compositeur allemand, entre au répertoire des Talens lyriques sur la scène du Châtelet dans la mise en scène de Jeanne Desoubeaux.

Sans doute moins connu que le célèbre Rinaldo, l'Orlando de la création affiche dans le rôle titre le castrat Francesco Bernardi (1686-1758) dit Senesino qui, tombé malade au bout de la dixième représentation, met brutalement fin à la production. Ainsi restée dans l'oubli durant près de deux siècles, la partition n'est remise au goût du jour qu'en 1922 et compte aujourd'hui parmi les plus belles réussites de son auteur.
Le livret laissé dans l'anonymat s'inspire de Carlo Sigismondo Capece, de Grazio Braccioli et de l'Orlando furioso de l'Arioste. Ce sont l'amour, la jalousie et la violence qui sont au cœur du propos. Le chevalier Orlando est tombé amoureux d'Angelica, princesse de Cathay qui lui a sauvé la vie ; mais Angelica aime Medoro, un sarrasin recueilli par la bergère Dorinda qui en est elle-même amoureuse. Dorinda surprend les deux amoureux qui lui avouent leur liaison. Dépitée, elle révèle le secret à Orlando. Fou de jalousie, celui-ci se prépare à la vengeance, veut tuer ses rivaux et mettre le feu à la maison d'Angelica. Mais Zoroastro, le mage, veille au grain, protège les deux amants et fait boire un filtre d'oubli à Orlando. À son réveil, réapparaissent Angelica et Medoro qu'il croyait avoir tués tandis que Zoroastro, deus ex machina, plaide en faveur de la sagesse.

À travers le regard des enfants
Quatre grandes toiles sont accrochées aux parois du décor, dont le célèbre portrait de Madame Vigée Le Brun et sa fille (pour la thématique amoureuse) et la Lutte de Jacob avec l'ange de Delacroix (pour la guerre). Nous sommes dans un musée avec un groupe d'enfants et leur enseignante : un choix de mise en scène très singulier de la part de Jeanne Desoubeaux qui a l'avantage de retenir dans les murs de l'établissement une poignée d'enfants-danseurs (issus des conservatoires d'Île-de-France) qui vont accompagner les personnages durant tout le spectacle. Le chef d'orchestre Christophe Rousset est l'un des visiteurs de la galerie, qui regagne la fosse au début de l'opéra. Les enfants dansent durant l'ouverture tandis qu'Orlando fait son apparition en franchissant le cadre d'un des tableaux, un des tours de magie de Zoroastro qui règne sur les lieux. On pousse des panneaux pour changer de décor (la scène de bergerie avec Dorinda), on ouvre l'espace vers l'extérieur (bosquet au clair de lune) et on fait disparaître toute la structure à la fin du deuxième acte avant de la voir réapparaître à la fin du spectacle. Les murs montent dans les cintres puis redescendent, évoquant la machinerie de l'opéra baroque. En bref, une manière de dialogue entre temps présent et passé reculé à travers le regard de la jeunesse. Si les charmantes têtes blondes nous réjouissent autant par leur spontanéité que leur vitalité, la « chorégraphie » n'est pas toujours au cordeau et la conduite d'acteurs ne va pas sans faiblesse.

Si Orlando était une femme…
Partagé entre son désir de partir à la guerre et son amour irrépressible pour Angelica, Orlando, incarné dans la production par la mezzo-soprano Katarina Bradić, fait davantage valoir son déchirement intérieur que la vaillance du guerrier. Cheveux longs et corset « baleiné » sur sa tunique aux manches bouffantes (costume d'Alex Costantino), cet anti-héros assume sa part de féminité. Le timbre ambré de la mezzo a du charme, la voix flexible est expressive dans les récitatifs mais souvent concurrencée par l'orchestre dans les airs. Il faut tendre l'oreille pour apprécier son aria de fureur à la fin du deuxième acte – la chanteuse, il est vrai, est annoncée, au début de la soirée, affaiblie par une grippe récente. Et si l'on s'ennuie ferme dans le troisième acte, elle sait cependant nous toucher dans son « lamento » Gia l'ebro mio ciglio, accompagné par les seuls luth et cordes frottées lorsqu'elle recouvre la raison.

Le trouple amoureux
Aux côtés de ses deux amoureuses (Angelica et Dorinda), le rôle de Medoro, au costume peu seyant, est également endossé par une femme, la mezzo-soprano Elisabeth DeShong dont l'aisance vocale et la technique irréprochable font merveille, autant dans les récitatifs que dans les airs. La fraicheur du timbre de Giulia Semenzato, soprano mozartienne, séduit dans son premier air de bergère même si la voix, par la suite, manque d'articulation et de souplesse dans les récitatifs. Si le chant n'est pas toujours bien contrôlé, le timbre lumineux et l'ampleur vocale de la soprano Siobhan Stagg/Angelica sied bien à ce rôle de reine : son air Verdi prati, convoquant les flûtes à bec, séduit, tout comme son duo avec Medoro, Ritornava al suo bel viso, dans l'acte I. Réunies à la fin du premier acte dans le seul trio de la partition, bien conduit sous l'autorité magistrale de la mezzo Elisabeth DeShong, les trois dames tout en sensualité et élans amoureux (avec les aigus stratosphériques de Semenzato) font courir un frisson érotique sur le plateau ! Angelica a quitté son habit de souveraine aux tons pastels pour ne garder, dans l'acte suivant, que le « panier » de sa robe : « […] comme si j'avais déshabillé le sujet d'un tableau exposé au musée », explique le costumier Alex Costantino dans sa note d'intention.
Deus ex machina
Fil rouge de ce drame de la jalousie et du dépit amoureux, Zoroastro, le magicien philosophe doit conduire l'action de cet opera seria vers son issue heureuse. Haendel le dote de trois grands airs assumés en beauté par Ricardo Novaro dont la présence scénique n'a d'égale que la vaillance de sa voix de baryton basse. Après une première intervention où il exhorte Orlando d'oublier Angelica (« Lasciar amor »), la voix rayonne pleinement dans l'air de l'acte II accompagné des bois de l'orchestre.
Conduits sans grande passion par Christophe Rousset, Les Talens lyriques dans la fosse servent au mieux les voix et font valoir leurs couleurs sans faire véritablement circuler le vent de folie que l'on attendait d'un « Orlando furioso ».
Crédit photographique : © Thomas Amouroux
Plus de détails
Paris. Théâtre du Châtelet. 23-I-2025. Georg Friedrich Haendel (1685-1759) : Orlando, opéra en trois actes ; livret d’un auteur anonyme, inspiré de Carlo Sigismondo Capece, de Grazio Braccioli et de l’Orlando furioso de l’Arioste ; mise en scène : Jeanne Desoubeaux ; scénographie : Cécile Trémolières ; costumes : Alex Costantino ; lumières : Thomas Coux dit Castille ; chorégraphie : Rodolphe Fouillot. Katarina Bradić, mezzo-soprano, Orlando ; Siobhan Stagg, soprano, Angelica ; Elisabeth DeShong, mezzo-soprano, Medoro ; Giulia Semenzato, soprano, Dorinda ; Riccardo Novaro, baryton basse, Zoroastro ; Nour Brunhes Esturgie, Adèle Moreau Penin, Orlando enfant ; Melina Masungi, Antoine Bouaziz, Angelica enfant ; Esteban Hernandez Sanchez, Ethan Darsoulant, Medoro enfant ; Daniel Hernandez Sanchez, Jasmine Sadouni Baghouli, Dorinda enfant. Figuration : élèves du Conservatoire Edgard Varèse/Conservatoire de Gennevilliers ; élèves du Conservatoire Ida Rubinstein/CRR ; Les Talens lyriques, direction : Christophe Rousset