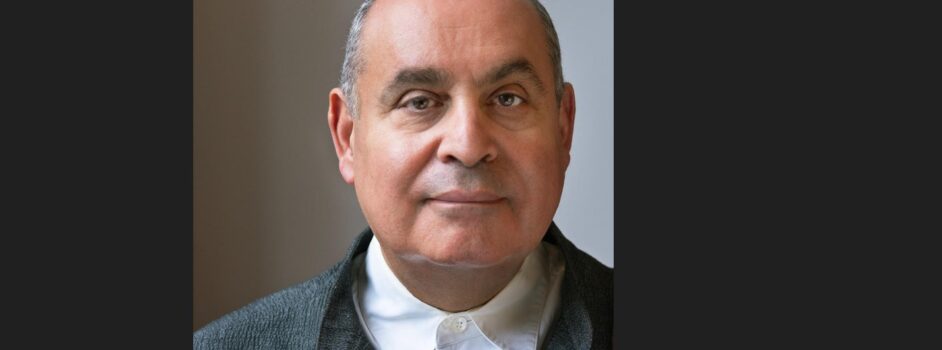Mozart en France : Le dernier grand voyage
Plus de détails
Entre le surmenage, les hypothèses d’empoisonnement, le dédain après la gloire et jusqu’à un enterrement sans office religieux ni caveau personnel, la fin de la vie de Mozart a laissé place à toutes les hypothèses les plus folles du génie abandonné. Mais l’oubli, si tant est qu’il y en ait eu un, a été de courte durée. Pour accéder au dossier complet : Hommage à Mozart
Le jeune virtuose brinquebalé sur les routes d'Europe par un père sourcilleux et pressé d'exploiter le génie de son fils ; cette image si évocatrice de l'enfance de Wolfgang Amadeus Mozart a été tant vue et rabâchée par la littérature, le cinéma, qu'elle semble aujourd'hui faire partie de l'imaginaire collectif.
 Il est vrai que la famille Mozart paraît avoir été affligée d'une bougeotte chronique : une chercheuse a ainsi calculé que Mozart avait consacré environ 250 jours de sa courte vie à des voyages, dont la plus grande partie avant ses quinze ans ! À une époque où les déplacements étaient nettement plus difficiles qu'aujourd'hui, le chiffre paraît étonnant. Mais comme de tout ce qui est trop évident, trop émouvant, et si facile à vendre par les médias, il faut se méfier de ces clichés apitoyants et romantiques qui font de Mozart un éternel enfant innocent et génial en butte à l'incompréhension et à l'envie de tous. Il existe d'ailleurs un remède très simple pour éviter cet écueil : revenir aux documents d'époque les plus fiables. Car on le sait peu, mais la plupart des ouvrages plus ou moins romancés qui ont été consacrés au compositeur — et ce n'est sans doute pas fini — puisent aux mêmes sources, en nombre limité, et réunies de 1847 à 1859 par le musicologue Otto Jahn.
Il est vrai que la famille Mozart paraît avoir été affligée d'une bougeotte chronique : une chercheuse a ainsi calculé que Mozart avait consacré environ 250 jours de sa courte vie à des voyages, dont la plus grande partie avant ses quinze ans ! À une époque où les déplacements étaient nettement plus difficiles qu'aujourd'hui, le chiffre paraît étonnant. Mais comme de tout ce qui est trop évident, trop émouvant, et si facile à vendre par les médias, il faut se méfier de ces clichés apitoyants et romantiques qui font de Mozart un éternel enfant innocent et génial en butte à l'incompréhension et à l'envie de tous. Il existe d'ailleurs un remède très simple pour éviter cet écueil : revenir aux documents d'époque les plus fiables. Car on le sait peu, mais la plupart des ouvrages plus ou moins romancés qui ont été consacrés au compositeur — et ce n'est sans doute pas fini — puisent aux mêmes sources, en nombre limité, et réunies de 1847 à 1859 par le musicologue Otto Jahn.
Pour les voyages, la correspondance de Mozart et des membres de sa famille, publiée dans les années 60 en Allemagne et dans les années 80 en France, est la meilleure source dont nous disposions — c'est d'ailleurs à peu près la seule, à part quelques journaux comme celui de Grimm, des publicités et quelques comptes-rendus de concerts souvent très brefs.
Il s'agit d'abord, pour le premier séjour à Paris, des lettres que Leopold Mozart envoie à Lorenz Hagenauer, son propriétaire et néanmoins ami, à qui il a emprunté l'argent du voyage. En retour, il le tient régulièrement informé des progrès de ses affaires — il s'agit de montrer que l'argent est bien employé… Cette correspondance n'était pas uniquement à but privé et a sans doute circulé dans les salons salzbourgeois ; à son retour Leopold fait d'ailleurs copier toutes ses lettres. On y trouve donc toutes sortes d'indications touristiques : descriptions de paysages, de costumes, curiosités et monuments, études des mœurs locales, considérations politiques, prix des repas et des principaux aliments, état des routes, tarifs des transports, taux de change. Cette correspondance est donc un vrai « Guide du routard », parfois fastidieux, souvent intéressant, dont on retient surtout qu'il ne devait pas être simple de voyager dans la mosaïque des principautés allemandes à l'époque.
Lors de son second séjour, Wolfgang part avec sa mère et écrit plus ou moins régulièrement à Leopold, selon son humeur et l'état de ses relations avec son père. En lisant ces lettres de façon objective, ce qui n'est pas si facile, on s'aperçoit très bien des petits mensonges que Mozart fait à son père, si transparents que Leopold les perce tout de suite à jour. Le père s'emporte, conseille, gronde, raisonne, console, rassure. Le fils esquive, embellit, se plaint, ment, se confie, rêve tout haut. Se dessine alors une sorte de dialogue à distance très touchant entre un tout jeune homme, seul loin de chez lui pour la première fois — car la pauvre Anna Maria ne semble pas avoir eu voix au chapitre — et un père aimant, rationnel, un peu donneur de leçon, et surtout très inquiet de voir son cher Wolfgang perdre son temps en songes absurdes. Un père comme tous les pères, en fait, qui imagine un avenir brillant pour ce fils pour lequel il a une intense admiration et sur qui il a fondé de si grands espoirs.
On découvre ainsi un visage très différent du compositeur, très éloigné de l'habituelle imagerie d'Epinal. Un Mozart joyeux, étourdi, rêveur, un tout jeune homme immature qui tombe sans cesse amoureux, fait des projets fous et grandioses sans en réaliser un seul, gaspille son énergie, se montre tout à la fois très sûr de sa valeur et trop timide pour s'imposer dans la société parisienne du XVIIIe siècle. Un Mozart pas toujours franc ni honnête avec lui-même, un peu prétentieux et souvent maladroit, très amusant mais un peu vulgaire, bref un Mozart humain.
Premiers voyages
Leopold Mozart découvre très tôt les talents musicaux de son fils ; tandis qu'il donne ses premières leçons de clavecin à sa sœur Maria Anna (1751-1829), dite Nannerl, âgé de huit ans, le jeune Wolfgang, qui en a à peine trois, s'amuse à chercher les accords parfaits sur le clavier. Un an plus tard, il commence à jouer les morceaux appris par sa grande sœur ; un an encore et il compose ses premières pièces, que Leopold prend pieusement en dictée.
Janvier 1762. Wolfgang a six ans et joue si bien que Léopold entreprend un premier voyage de trois semaines à Munich pour montrer ce prodige au prince Maximilien III. Puis, le 18 septembre de la même année, toute la famille part à Vienne, en passant par Passau et Linz. Wolfgang joue dans les salons de l'aristocratie, rencontre l'ambassadeur de France et fait partout attraction. Le 13 octobre, il joue même à Schönbrunn devant François I et Marie-Thérèse, qui fait don aux enfants de deux habits de cour. Mais Wolfgang attrape la scarlatine et l'enthousiasme de la noblesse viennoise se tarit quelque peu. Leopold tombe malade à son tour, et comme le poste de maître de chapelle de Salzbourg — que Leopold briguera toute sa vie en vain — se libère, la famille rentre au foyer le 5 janvier 1763. C'est finalement Michaël Haydn (1737-1806) qui est nommé, frère cadet de Joseph et ami de la famille Mozart.
Le Grand Tour d'Europe de 1763-1766
Mais Léopold a déjà planifié un nouveau voyage plus important et a rassemblé des renseignements et des adresses en Hollande, France, Angleterre et Italie. Un vrai « Grand Tour » tel que l'ont popularisé alors les voyageurs anglais, avant que Stendhal ne les appelle « touristes ». Il demande un congé et, le 9 juin 1763, toute la famille accompagnée d'un valet de chambre-coiffeur s'embarque pour un voyage de trois ans.
Ils font d'abord une tournée des cours allemandes : Munich, Augsbourg, Ulm, Ludwigsbourg, Mayence, Coblence, Aix la Chapelle, au gré du bon vouloir de tel prince ou des aléas du voyage. Au début, ils ne sont attendus nulle part, et Leopold compte sur les lettres d'introduction qu'il s'est fait donner à Vienne, puis la renommée des enfants s'étend et ils sont annoncés de ville en ville. Surtout, très vite, il est clair que les dons de Wolfgang dépassent de loin ceux de sa sœur, ce dont elle souffre. Leopold a alors l'intelligence de changer un peu son programme : Wolfgang est présenté comme compositeur et improvisateur, alors qu'il s'attache plus à mettre en valeur la virtuosité de Nannerl.
En juillet, les Mozart s'arrêtent à Schweitzingen, résidence d'été de l'électeur palatin Karl-Theodor, où ils entendent l'orchestre de Mannheim, alors le meilleur d'Europe. Ils rencontrent le directeur de l'orchestre, Christian Cannabich (1731-1798), et Léopold remarque particulièrement le talent du flûtiste Johann-Baptist Wendling (1723-1797) ; tous deux deviendront des amis de Mozart lors de son second voyage.
Une halte à Francfort en août est un grand succès, ils y restent deux semaines. Un prospectus rédigé sans doute par Leopold donne une idée de la façon dont se déroulaient ces concerts, plus proches de l'attraction de foire que du concert classique.
L'admiration universelle qu'éveille dans les âmes de tous les auditeurs l'habileté — jamais encore vue ni entendue à un pareil degré — des deux enfants du maître de chapelle du prince archevêque de Salzbourg, M. Leopold Mozart, a eu pour conséquence déjà une triple répétition du concert qui ne devait d'abord être donné qu'une seule fois.
Oui, et c'est cette admiration universelle, jointe au désir exprès de plusieurs grands connaisseurs et amateurs de notre ville, qui est cause que, aujourd'hui mardi 30 août, à six heures du soir, dans la salle Scharf, montagne Notre-Dame, aura lieu un dernier concert, mais cette fois irrévocablement le dernier.
Dans ce concert paraîtront la petite fille qui est dans sa douzième année et le petit garçon qui est dans sa septième. Non seulement tous deux joueront des concertos sur le clavecin ou le piano-forte — et la petite fille, même, jouera les morceaux les plus difficiles des plus grands maîtres — mais en outre le petit garçon exécutera un concerto sur le violon ; il accompagnera au piano les symphonies ; on recouvrira d'un drap le clavier du piano et par-dessus ce drap l'enfant jouera aussi parfaitement que s'il avait les touches devant les yeux, il reconnaîtra aussi, sans la moindre erreur, à distant, tous les sons que l'on produira, seuls ou en accords, sur un piano ou sur tout autre instrument imaginable, y compris des cloches, des verres, des boîtes à musique, etc… Enfin, il improvisera librement (aussi longtemps qu'on voudra l'entendre, et dans tous les tons qu'on lui proposera, même les plus difficiles), non seulement sur le piano, mais en encore sur un orgue, afin de montrer qu'il comprend aussi la manière de jouer de l'orgue, qui est tout à fait différente de la manière de jouer du piano. Le prix sera d'un petit-thaler par personne. On peut se procurer des billets à l'Auberge du Lion d'Or.
Puis c'est l'arrivée en Belgique : Liège, Louvain et Bruxelles le 4 octobre. Leopold peste contre les habitants — « le peuple le plus méchant du monde » —, s'extasie sur la peinture flamande, et les Mozart attendent plusieurs semaines le bon plaisir du prince Karl, frère de l'empereur François Ier qui veut entendre Wolfgang et lui interdit donc de se produire avant, ou de quitter la ville. Finalement, le concert a lieu le 14 octobre 1763 en présence du prince, et c'est un grand succès. Mozart compose une première sonate pour piano, où se sent une influence importante de la musique française, notamment de Johann Gottfried Eckard (1735-1809), allemand installé en France, qui venait de publier six sonates semblables. À Paris, Mozart lui ajoute un accompagnement de violon pour en faire la sonate pour piano et violon K. 6.
Ils arrivent à Paris le 19 novembre 1763, à trois heures et demie de l'après-midi et logent à l'Hôtel de Beauvais, chez le comte Van Eyck, ambassadeur de Bavière. Le très catholique Leopold est surpris de la dissolution des mœurs françaises : impossible de faire maigre le vendredi ! Il entame aussitôt une tournée des personnes qui lui avaient été recommandées : échec sur toute la ligne, aucune des recommandations, même les plus prestigieuses, ne lui ouvre de portes. Mais grâce à une lettre donnée par la femme d'un commerçant de Francfort, il rencontre Friedrich-Melchior Grimm (1723-1807), philosophe, ami de tous les grands penseurs de l'époque, secrétaire du duc d'Orléans. Grimm est étonné du génie de Wolfgang et écrit, dans sa Correspondance littéraire, le 1er décembre 1763 :
Les vrais prodiges sont assez rares pour qu'on n'oublie pas des les signaler lorsqu'on a l'occasion d'en voir un. Un maître de chapelle de Salzbourg, nommé Mozart, vient d'arriver ici avec deux enfants de la plus jolie figure du monde. Sa fille âgée de onze ans, touche le clavecin de la manière la plus brillante ; elle exécute les plus grandes pièces et les plus difficiles avec une précision à étonner. Son frère, qui aura sept ans au mois de janvier prochain, est un phénomène si extraordinaire qu'on a de la peine à croire ce qu'on voit de ses yeux et ce qu'on entend de ses oreilles. C'est peu pour cet enfant d'exécuter avec la plus grande précision les morceaux les plus difficiles avec des mains qui peuvent à peine atteindre la sixte ; ce qui est incroyable, c'est de le voir jouer de tête, pendant une heure de suite, et là, s'abandonner à l'inspiration de son génie et à une foule d'idées ravissantes qu'il sait encore faire succéder les unes aux autres avec goût et sans confusion. Le maître de chapelle le plus consommé ne saurait être plus profond que lui dans la science de l'harmonie et des modulations, qu'il sait conduire par les routes les moins connues mais toujours exactes. […] Vous jugez bien qu'il ne lui coûte rien de transposer et de jouer l'air qu'on lui présente, dans le temps qu'on exige ; mais voici ce que j'ai encore vu, et qui n'en est pas moins incompréhensible. Une femme lui demande l'autre jour s'il accompagnerait bien d'oreilles, sans la voir, une cavatine italienne qu'elle savait par cœur ; elle se mit à chanter. L'enfant essaya une basse qui n'était pas absolument exacte, parce qu'il est impossible de préparer d'avance l'accompagnement d'un chant qu'on ne connaît pas ; mais l'air fini, il pria la dame de recommencer, et à cette reprise, il joua non seulement de la main droite le chant de l'air, mais il mit, de l'autre, la basse sans embarras. Après quoi, il pria dix fois de suite de recommencer, et à chaque reprise, il changea le caractère de son accompagnement ; il l'aurait fait répéter vingt fois si on ne l'avait fait cesser. Je ne désespère pas que cet enfant ne me fasse tourner la tête, si je l'entends encore souvent ; il me fait concevoir qu'il est difficile de se garantir de la folie en voyant des prodiges.
Grâce à lui, les Mozart peuvent ainsi enfin entrer dans les salons de l'aristocratie, rencontrer des musiciens comme Philidor, compositeur d'opéra-comique alors célèbre, et être reçu à la cour, d'abord par Madame de Pompadour (1721-1764), ancienne maîtresse de Louis XV, que Leopold trouve « encore belle » — elle a 43 ans — mais « extrêmement hautaine ». Puis, fin décembre, la famille est invitée au Grand Couvert et approche enfin Louis XV et la reine Marie Leszcynska. Leopold est étonné par la froideur de l'étiquette et les enfants reçoivent toutes sortes de cadeaux précieux et inutiles : tabatières en or, montres précieuses, boîte à cure-dents…
Fin février, Wolfgang dédie un recueil de sonates pour clavecin et violon à Victoire-Anne-Marie de Savoie, Princesse de Carignan, seconde fille de Louis XV — sa première grande œuvre imprimée — qu'il lui remet en mains propres. Un second recueil est dédié à la comtesse de Tessé, dame d'honneur de la Dauphine et, surtout, maîtresse du Prince de Conti. Les concerts se suivent, l'argent rentre : 1 200 livres sont versés par les Menus plaisirs du Roi « pour avoir fait exécuter de la musique par ses enfants en présence de la famille royale ». Wolfgang est le centre d'intérêt de la grande noblesse française, il est partout fêté, les sonates se vendent très bien, on s'arrache ses portraits comme la reproduction du dessin de Carmontelle représentant la famille, Leopold fait la connaissance de la plupart des ambassadeurs européens.
Au milieu de toute cette agitation, Wolfgang reste avant tout un enfant obéissant, mais parfois « un peu polisson », un beau petit garçon très bien élevé, très affectueux, capable de se jeter au cou de reines et princesses, et de dire à Madame de Pompadour, ayant un geste pour le repousser « Qui est-elle pour refuser de m'embrasser ? » Il n'est pas si flatté de l'attention qu'on lui porte, et refuse de jouer si l'auditoire n'est pas vraiment connaisseur. Son père doit mentir et l'assurer partout que les spectateurs sont de fins mélomanes.
Après cinq mois à Paris, la famille part pour Calais le 10 avril. Les enfants voient la mer pour la première fois, tout le monde a le mal de mer. Ils arrivent à Londres le 23 et y restent près de seize mois. Là, grâce au succès parisien, les choses vont très vite ; ils sont reçus le surlendemain de leur arrivée par George III et Johann-Christian Bach (1735-1682), professeur de la reine, se prend d'affection pour le jeune compositeur. Jean-Chrétien lui apprend le style de l'ouverture italienne. Les concerts ne comblent pas les attentes de Leopold, mais l'inspiration est là, Wolfgang semble saisi d'une fringale de composition : il écrit ses premières symphonies, d'autres sonates pour clavecin et violon qui paraissent avec une dédicace à la reine d'Angleterre, une sonate pour piano à quatre mains, et ses premiers essais de musique lyrique sur les conseils du castrat Giovanni Manzuoli, qui lui donne des leçons de chant et l'emmène sans doute à l'opéra. Il compose quinze airs italiens, dont seuls trois nous sont parvenus, pour ténor (K. 21 et K. 23 et 36)
Leopold aurait aimé continuer par l'Italie, mais sur l'invitation pressante de l'ambassadeur de Hollande, ils partent pour La Haye. Nannerl y tombe gravement malade, au point qu'on lui administre l'extrême-onction, puis Wolfgang huit jours plus tard. La famille part pour Amsterdam donner quelques concerts, Mozart compose sa symphonie N° 5 K. 22, et six sonates pour clavecin avec accompagnement de violon, K. 26 à 31 qui sont aussitôt publiées.
Et c'est Paris à nouveau, où Leopold espère bien renflouer les finances familiales, mises à mal par la maladie des enfants. Ils y arrivent le 10 mai 1766 et sont reçus deux fois à Versailles où ils résident du 28 mai au 1er juin 1766. Wolfgang ne compose guère, seulement un petit Kyrie K. 33, sa première œuvre religieuse. Puis c'est le retour à Salzbourg ; sur l'invitation du prince de Condé, la famille passe d'abord à Dijon, où avaient lieu les états généraux de Bourgogne. Ils restent ensuite un mois à Lyon et donnent un concert le 13 août. Puis c'est la Suisse : Genève, où ils essaient en vain de rencontrer Voltaire, malade ; Berne, Zurich. Partout, les enfants sont attendus avec impatience et curiosité, donnent des concerts, rencontrent les personnalités locales. Il leur faut cinq mois pour arriver à Salzbourg !
En général, les biographes de Mozart désapprouvent fort ces voyages de jeunesse, en accusant Leopold d'avoir en quelque sorte exhibé son fils comme un singe savant. Or, dans ses lettres, on sent constamment l'amour et les soins dont il entoure ses enfants, comme son souci pédagogique de leur faire découvrir chaque ville qu'ils traversent, ses églises, les tableaux des grands maîtres, les grands savants. Surtout, outre le désir de montrer son « petit prodige », Leopold voulait sans doute faire découvrir à Wolfgang ce qui se faisait ailleurs dans l'Europe musicale, lui faire rencontrer de grands musiciens et penseurs. À son retour à Salzbourg, Wolfgang n'est plus seulement un « petit prodige » mais un vrai compositeur, capable, grâce aux leçons reçues, de maîtriser les formes les plus complexes de la musique du temps. Surtout, ces voyages en France lui ont permis de s'imprégner fortement de musique française qui a donc été sa première influence étrangère, avant la musique italienne qu'il découvrira réellement en 1769 après en avoir eu un premier aperçu grâce à Jean-Chrétien Bach. D'ailleurs, dès son retour à Salzbourg, il compose plusieurs concertos pour piano — K. 37, 39, 40 et 41 — arrangements de mouvements de sonates de compositeurs divers, dont Schobert et Eckard, deux maîtres allemands installés à Paris.
Ce voyage aura cependant un effet négatif : celui d'emprisonner Mozart dans le rôle de l'éternel enfant courant les routes. Cette image le desservira longtemps ; ainsi, l'impératrice Marie-Thérèse déconseille-t-elle à son fils Ferdinand de prendre Wolfgang à son service arguant que « cela avilit le service, quand ces gens courent le monde comme des gueux.
L'Italie
Les années passent ; Wolfgang et son père font en 1769, durant quinze mois, un grand voyage en Italie. Wolfgang reçoit des mains de Clément XIV le titre de Chevalier de l'Eperon d'Or, décoration également attribuée à Gluck, et le Padre Martini (1706-1784), professeur de Jean-Chrétien Bach, lui donne des cours et le reçoit comme membre de L'Academia filarmonica de Bologne. À Milan, où ils sont pour le carnaval, Mozart rencontre Giambattista Sammartini (1700-1775), autre professeur de Jean-Chrétien, et reçoit la commande d'un opéra pour le carnaval suivant ; ce sera Mitridate, Re di Ponto créé le 26 décembre 1770 avec grand succès. Du coup, on lui en commande un nouveau, Ascanio in Alba, créé le 21 août 1771, puis un autre encore, Lucio Silla, qui est reçu de façon honorable, mais pas avec assez d'enthousiasme pour qu'une nouvelle commande lui soit passée.
Le retour à Salzbourg est sombre. En 1771, le vieux prince-archevêque Sigismond von Schrattenbach meurt, et son successeur, Hieronymus Colloredo (1732-1812), prince réformiste, entreprenant et moderne, mais également autoritaire et méprisant, se fait vite détester. Surtout, il ferme le théâtre, réorganise sa chapelle musicale et réduit les dépenses artistiques. Pourtant, on commande une sérénade à Mozart pour son couronnement, Il sogno di Scipione, et il le titularise comme Konzertmeister de sa cour. Mais, très vite, il apparaît à Wolfgang qu'il n'a guère d'avenir ou de promotion possible à attendre, car Colloredo n'apprécie pas sa musique et ne manque pas de le lui dire, comme l'écrit Leopold au Padre Martini :
Voici l'histoire : il y a plus de 5 ans que mon fils est au service de notre prince pour un salaire de misère, dans l'espoir que petit à petit on finirait par apprécier ses efforts et ses faibles connaissances, alliées à son zèle immense et à ses études incessantes. Mais nous nous sommes trompés ! Je renonce à vous brosser un tableau de la façon de penser et d'agir de notre prince, mais me contente de dire qu'il n'a pas eu honte d'affirmer que mon fils ne sait rien, qu'il devrait aller étudier la musique dans un conservatoire de Naples. Et pourquoi tout cela ? Pour que nous comprenions bien, après avoir entendu ces paroles définitives de la bouche d'un prince, qu'un simple sujet tel que lui serait fou de se persuader qu'il mérite un salaire plus élevé et une plus grande reconnaissance. (22 décembre 1777)
Il faut partir. Le 14 juillet, les Mozart père et fils reprennent le chemin de Vienne, pour briguer sans succès le poste de Konzertmeister à la cour. Ils rentrent néanmoins avec la commande d'une musique d'accompagnement pour Thamos, roi d'Egypte. Puis c'est Munich du 6 décembre 1774 au 7 mars 1775, pour la création de La finta giardiniera. Il faut tenter sa chance ailleurs, Leopold demande plusieurs congés, que Colloredo refuse tous, ce qui oblige Wolfgang à donner sa démission en août 1777.
Second Voyage à Paris
Son père étant obligé de rester à son poste, il part avec sa mère, Anna Maria, le 23 septembre 1777. Ce sera sans aucun doute le plus important de ses voyages.
Si Léopold est abattu, Wolfgang, lui, se sent joyeux d'être enfin libéré du poids qui l'accablait :
Je suis toujours dans ma plus excellente humeur. Mon cœur est aussi léger qu'une plume, depuis que je suis loin de ces chicanes — j'ai même déjà engraissé. (26 septembre).
Ses lettres nous disent toute la joie de ce jeune homme de vingt et un ans libéré de la tutelle paternelle, loin des pesanteurs de la cour et de son atmosphère de mépris. Il est très content de lui, protecteur avec sa mère — « je suis un autre papa » — blagueur, parfois lourdement.
Leur première destination est Munich, où Wolfgang espère bien obtenir un poste. Il rencontre le comte Joseph Anton Seeau, Intendant des spectacles, et a une entrevue avec le prince électeur Maximilian III Joseph, malheureusement négative, ce qui ne surprend guère Leopold. Puis c'est Augsbourg, où il visite l'atelier du facteur de pianos Stein, sans doute l'un des plus célèbres de l'époque et rencontre sa fille, future amie de Beethoven, dont la mauvaise technique pianistique l'amuse fort. Il donne des concerts, joue de l'orgue, du violon, et du pianoforte, dont des pièces du strasbourgeois Johann-Friedrich Edelmann et peut-être d'autres compositeurs français.
Une grande étape les attend, avec la visite tant attendue à Mannheim. Les Mozart y retrouvent Johann Baptist Wendling et Christian Cannabich, avec qui Wolfgang se lie d'une profonde et durable amitié. Il mange presque tous les jours chez les Cannabich, donne des cours de piano à la fille, Rosina Theresia Petronella, que l'on appelle plus simplement Rosa, et compose pour elle sa Sonate en Ut majeur K. 309. Visiblement, les soirées semblent avoir été plutôt animées et pas nécessairement musicales :
Moi, Johannes Chrysostomus Amadeus Wolfgangus Sigismondus Mozart, je m'accuse de n'être rentré qu'à minuit à la maison, hier et avant-hier (et souvent déjà), et d'avoir de dix heures à ladite heure, chez Cannabich, en sa présence et en compagnie de sa femme, de sa fille, de M. le Trésorier, de Ramm et de Lang, souvent — et sans remords mais très légèrement — rimaillé. De plus, uniquement de cochonneries avec crotte, chier et lécher le cul, en pensée, en paroles, et — mais pas en action. Je ne me serais pas conduit d'une façon si dévergondée, si l'instigatrice — la dénommée Lisel (Elisabeth Cannabich) ne m'y avait poussé et excité ; mais je dois avouer que j'y ai pris grand plaisir. Je reconnais du fond du cœur tous ces péchés et ces écarts dans l'espoir d'avoir assez souvent à les confesser, et prends la ferme résolution d'amender toujours plus la vie dissolue que j'ai commencée à mener. — C'est pourquoi je demande la sainte absolution, si elle peut s'obtenir facilement. Sinon cela m'est égal, car que le jeu continuera. Lusus enim suum habet ambitum comme le chante le bienheureux Meissner, chapitre 9 page 24, et aussi le saint Ascenditor [le cafetier Staiger ; steigen = monter], patron du potage au café brûlé, de la limonade moisie, du lait aux amandes sans amandes, et tout particulièrement de la glace aux fraises remplie de glaçons, puisqu'il est un grand connaisseur et artiste en matière de choses glacées. (14 novembre 1777)
Il soupe également chez Wendling, écrit l'air « Basta vincesti » K. 486a pour sa femme Dorothea et semble tomber sous le charme de sa fille Augusta, surnommée Güstl, beauté célèbre, un temps la maîtresse du prince Karl-Theodor, et qu'il trouve « pas mal du tout ». Il compose pour elle deux mélodies, ses deux premiers lieder, sur des textes français qu'elle a elle-même choisis : « Oiseaux si tous les ans » K. 307 et « Dans un bois solitaire » K. 308.
Ce séjour à Mannheim est un moment béni pour Mozart. Il est partout fêté, pris au sérieux, fréquente les salons, rencontre l'écrivain Wieland ; on lui commande des œuvres, notamment Ferdinand Dejean, chirurgien de la Compagnie des Indes et flûtiste amateur pour qui il écrit ses deux concertos pour flûte (K. 313 et K. 314) et ses deux quatuors pour flûte et cordes (K. 285 et 285a). Il s'installerait volontiers dans cette ville, d'autant qu'il sympathise avec le Prince électeur Karl-Theodor, qui l'emmène dans son vrai foyer — c'est-à-dire chez sa maîtresse, une comédienne dont il avait eu quatre enfants. Il retrouve chez ce prince ouvert et cultivé la même préoccupation de créer un véritable opéra allemand et entend au théâtre de Mannheim un opéra d'Ignaz Holzbauer (1711-1783), Günther von Schwarzbourg, qu'il apprécie beaucoup et qui influencera, selon Alfred Einstein, la Flûte enchantée.
Wolfgang essaie à tout prix de se faire engager ou au moins de se faire commander un opéra. Mais Karl-Theodor, après lui avoir fait longtemps attendre sa réponse, ne le prend pas à son service. Entre-temps, il a succédé à l'Electeur de Bavière et doit partir pour Munich ; il va bientôt réorganiser totalement sa chapelle, ce sera d'ailleurs la fin de l'importance musicale de Mannheim. Wolfgang a dépensé tout son argent et Leopold est de plus en plus inquiet : il s'est très fortement endetté pour Wolfgang, a sacrifié sa fille pour lui — elle commence elle aussi à composer mais doit participer aux frais en donnant des leçons — et Nannerl s'est même endettée à son tour quand le crédit de son père a été épuisé ; et tout cela sans résultat pour l'instant.
Finalement, sur les conseils de Wendling, Wolfgang décide de tenter sa chance à Paris ; après tout c'est la ville où les gloires européennes s'affirment, et il y a peu de bons compositeurs français. Mais Leopold doute de la capacité de son fils à se gérer seul et lui rappelle :
Le but de ce voyage, le but inéluctable, était et doit être d'obtenir un emploi ou de gagner de l'argent. Jusqu'à maintenant, il me semble n'y avoir d'espoir ni pour l'un ni pour l'autre, à moins que cela doive rester un secret pour moi. (27 novembre 1777).
Si le séjour à Mannheim s'éternise, ce n'est pas seulement parce que Wolfgang garde jusqu'au bout, contre toute logique, le secret espoir d'y obtenir un poste. Il a rencontré une jeune cantatrice de dix-sept ans dont le talent et la beauté l'enthousiasment, Aloisia Weber (1761-1839). Elle est la fille de Franz Fridolin Weber, basse, souffleur et copiste de l'opéra de Mannheim, père de trois autres filles : Josepha (1758-1815), Constanze (1762-1842) — future Madame Mozart — et Sophie (1763-1846) et d'un garçon. Il est éperdument amoureux et fait même un instant le rêve de partir avec elle sur les routes d'Italie ; il lui écrira en chemin des opéras qui la rendront célèbre et gagnera beaucoup d'argent. Son père n'est pas hostile à l'idée de voir son fils s'installer à Mannheim, même s'il a peu d'espoir qu'il obtienne un poste, mais il manque s'étrangler en découvrant ses nouveaux projets :
Ton idée (je peux à peine écrire quand j'y pense), l'idée de faire des tournées avec M. Weber et ses deux filles a failli me rendre fou. Mon cher fils ! Comment peux-tu être séduit, serait-ce même une heure, par une idée aussi absurde qu'on ta mise en tête ? Ta lettre n'est qu'un roman. (12 février 1778)
Et puis, les Weber sont pauvres, comment pourrait-il faire vivre une famille si nombreuse ? Il soupçonne d'ailleurs la jeune fille d'être intéressée : Wolfgang est une célébrité à Mannheim, son soutien peut être important pour sa future carrière. Il n'a d'ailleurs pas tort : dès qu'elle aura trouvé un engagement à Munich, Aloisia s'empressera d'oublier Wolfgang. Et puis, dans le même temps, Adlgasser, l'organiste de Salzbourg, est mort après une attaque durant la messe, et le Grand Chambellan propose de façon détournée à Leopold d'engager Wolfgang.
Wolfgang obéit et quitte à contrecœur la famille Weber. Il passa sa dernière soirée avec eux ; Aloisia pleure et lui offre deux paires de manchettes qu'elle a tricotées, son père donne à Wolfgang les comédies de Molière traduites en allemand. Et le 14 mars 1778, il repart pour un long et ennuyeux voyage de neuf jours, toujours accompagné de sa mère.
Mozart à Paris
Mais qui est ce jeune homme qui arrive à Paris ce 23 mars 1778 à quatre heures de l'après-midi ? Aussi précoce qu'ait été le talent de Mozart, ce n'est encore qu'un brillant virtuose plein d'avenir, et un compositeur talentueux parmi tant d'autres. Certes, il a beaucoup écrit : des messes de commande pour Salzbourg ; des sérénades ; une trentaine de symphonies ; quatre concertos pour piano (jusqu'au N° 8 K. 246, les premiers ne sont que des pastiches) ; ses cinq concertos pour violon ; plusieurs opéras dont La finta giardinera, Il re pastore et surtout Mitridate re di Ponto et Lucio Silla. Mais, même si ses dernières œuvres montrent un ton déjà plus personnel, aucune ne fait réellement partie de ses grands chefs d'œuvre les plus admirés aujourd'hui. Malgré cela, Mozart est parfaitement conscient de sa valeur :
Je suis un compositeur, né pour être maître de chapelle. Je ne dois ni ne peux enterrer le Talent pour la composition que Dieu, dans sa bonté, m'a prodigué de telle manière (je peux le dire sans orgueil, car je le ressens plus que jamais). (7 février 1778)
Un peu trop, peut-être, ce qui peut le rendre cassant, parfois même grossier, avec ceux qui ne comprennent pas son génie. Mais cette arrogance, comme les déclarations méprisantes dont ses lettres sont pleines, cachent sans doute sa timidité et sa gaucherie. Bref, il n'a pas l'entregent de son père, sa souplesse courtisane.
Pour les Français, Mozart est un inconnu, le souvenir de l'enfant prodige est sans doute bien oublié, aucune de ses œuvres récentes n'a été entendue à Paris. Et ce petit jeune homme emprunté, maigre, mal à l'aise, au français bien tudesque, n'a pas dû faire bien grande impression dans cette société policée et courtisane. Grimm d'ailleurs, résume parfaitement ce problème dans une lettre à Leopold :
Il est trop confiant, peu actif, trop aisé à attraper, trop peu occupé des moyens qui peuvent conduire à la fortune. Ici, pour percer, il faut être retors, entreprenant, audacieux. Je lui voudrais, pour sa fortune, la moitié moins de talent et le double plus d'entregent, et je n'en serais pas embarrassé. Au reste, il ne peut tenter ici que deux chemins pour se faire un sort. Le premier, c'est de donner des leçons de clavecin […] Ce métier ne lui plaira pas, parce qu'il l'empêchera d'écrire, ce qu'il aime par-dessus tout. Il pourrait donc s'y livrer tout à fait, mais en ce pays-ci le gros du public ne se connaît pas en musique. On donne par conséquence tout aux noms, et le mérite de l'ouvrage ne peut être jugé que par un petit nombre. Le public est dans ce moment-ci ridiculement partagé entre Piccinni et Gluck, et tous les raisonnements qu'on entend sur la musique font pitié ; il est donc très difficile pour votre fils de réussir entre ces deux partis. (27 juillet 1778)
Enfin, Wolfgang arrive à un mauvais moment : Paris est alors en pleine querelle des picciniste contre les gluckistes ; querelle stérile mais violente qui fait passer inaperçue l'arrivée de ce garçon sans doute mal à l'aise dans un milieu artistique si différent de celui qu'il a connu jusque-là. Mozart rend d'ailleurs visite à Piccinni, qui l'accueille courtoisement, mais ne prend pas parti dans la querelle.
Dès le surlendemain de son arrivée, Wolfgang rend visite à Grimm, Wendling, Raaf et quelques autres amis de Mannheim, en voyage à Paris. Il rencontre ainsi le comte Sickingen, grand amateur de musique à qui Cannabich a dédié des symphonies, chez qui il ira souvent avec Wendling. Il est mis en relation avec Joseph Le Gros (1739-1793), directeur du Concert Spirituel, Jean-Georges Noverre (1727-1810), maître de ballet de l'Opéra, et le comte de Guisnes, flûtiste amateur et favori de Marie-Antoinette qui lui demande des leçons de composition pour sa fille et commande le concerto pour flûte et harpe K. 299.
L'ambition de Mozart est de se révéler comme compositeur d'opéra, la seule façon de réussir alors à se faire un nom. Grâce à Noverre, la chose paraît un instant possible. Il lui fait rencontrer un librettiste et le premier acte d'une tragédie lyrique est écrit, Alexandre et Roxane. Puis on lui propose de reprendre le Démophon de Métastase. Finalement, rien de tout cela ne verra le jour. Noverre demande à Mozart d'écrire, gracieusement, un ballet Les Petits Riens K. 299b, pour étoffer une représentation de Le due gemelle, opera bouffe de Piccini qu'il qualifie de « misérable ». Le nom du compositeur n'apparaît pas sur l'affiche — c'était alors la règle, seul le nom du chorégraphe importait. Fin août, il est invité à Saint-Germain par le duc de Noailles. Il retrouve là son ancien maître, Jean-Chrétien Bach, à qui l'Opéra a commandé — quelle ironie ! — Amadis des Gaules qui sera créé en novembre 1779.
De même, le contact avec Le Gros n'apporte pas les fruits attendus. Le Gros lui commande une révision d'un Miserere d'Holzbauer et une symphonie concertante pour vents qui devait mettre en valeur ses amis de Mannheim, lui fait rencontrer François Joseph Gossec (1734-1829), considéré comme le « père » de la symphonie française, qu'il appelle « mon très cher ami » mais qu'il trouve « un homme bien austère ». Mais seuls deux des quatre chœurs du Miserere sont créés, et la symphonie concertante semble avoir été oubliée…
Legros l'avait depuis quatre jours pour la faire copier… mais je la retrouve toujours à la même place. En fin de compte, avant-hier, ne la voyant plus, je la cherche sous les partitions — et la découvre cachée. Je fais mine de rien et demande à Legros : « À propos, avez-vous fait copier la symphonie concertante ? » « Non. Je l'ai oubliée. » Comme je ne peux naturellement pas lui donner l'ordre de la faire copier ou jouer, je ne dis rien. Les deux jours où elle aurait dû être jouée, je suis allé au concert. Punto et Ramm vinrent vers moi, tout enflammés, et me demandèrent pourquoi on ne jouait pas ma symphonie concertante. « Je ne sais pas. Première nouvelle. Je ne suis au courant de rien. » Ramm est alors devenu enragé et s'est emporté contre Legros en français dans le salon de musique. (1er mai 1778)
Elle semble même perdue aujourd'hui, la partition retrouvée, en mi bémol majeur K 297 b semblant être un arrangement ultérieur, peut-être partiellement authentique.
Face à ces déconvenues, Mozart supporte de plus en plus mal d'être obligé de faire antichambre pour une noblesse parisienne qui lui montre peu d'égards :
Mon trés cher Pére ! Je dus attendre une demi-heure dans une grande pièce glaciale, non chauffée et sans cheminée. Finalement, la Duchesse Chabot arriva et me pria avec la plus grande amabilité de me satisfaire du piano qui était là, du fait qu'aucun des siens n'était en état ; elle me pria d'essayer. Je dis : j'aimerais de tout cœur jouer quelque chose, mais c'est impossible dans l'immédiat car je ne sens plus mes doigts tant j'ai froid ; et je la priai de bien vouloir me faire conduire au moins dans une pièce où il y aurait une cheminée avec du feu. « O oui Monsieur, vous avés raison. » Ce fut toute sa réponse. Puis elle s'assit et commença à dessiner, pendant toute une heure, en Compagnie d'autres messieurs, tous assis en cercle autour d'une table. Ainsi, j'ai eu l'honneur d'attendre une heure entière. Fenêtres et portes étaient ouvertes, j'avais froid non seulement aux mains mais également à tout le corps et aux pieds ; et je commençais tout de suite à avoir mal à la tête. C'était donc altum silentium. Je ne savais que faire, si longtemps, de froid, de mal de tête et d'ennui. Je pensais sans arrêt : si ce n'était pour M. Grimm, je partirais à l'instant même. Finalement, pour être bref, je jouai sur ce misérable affreux Pianoforte. Mais le pire est que Mad. et tous ces messieurs n'abandonnèrent pas un instant leur dessin, le continuèrent au contraire tout le temps, et je dus donc jouer pour les fauteuils, les tables et les murs. Dans des conditions aussi abominables, je perdis patience — je commençai les variations de Fischer, en jouai la moitié, et me levai. Il y eut une foule d'Éloges. Mais je dis ce qu'il y avait à dire : qu'il m'était impossible de me faire honneur sur ce piano et qu'il me serait très agréable de revenir un autre jour, lorsqu'il y aurait un meilleur instrument. Elle ne voulut toutefois pas céder, je dus encore attendre une demi-heure que son mari arrive. Il s'assit près de moi et m'écouta avec toute son attention ; j'en oubliai le froid, le mal de tête, et me mis à jouer — malgré le détestable piano —, comme je joue lorsque je suis de bonne humeur. Donnez-moi le meilleur piano d'Europe mais comme auditeurs des gens qui n'y comprennent rien ou qui ne veulent rien y comprendre, et qui ne sentent pas avec moi ce que je joue, j'y perds tout plaisir. […] Vous m'écrivez que je dois bravement faire des visiten pour faire des connaissances et rafraîchir les anciennes, mais ce n'est pas possible. À pied, tout est trop loin ou trop sale, car à Paris, il y a une saleté indescriptible. En voiture on a tout de suite l'honneur de dépenser 4 à 5 livres par jour, et pour rien, car les gens font certes des compliments, mais s'arrêtent là. Ils me demandent de revenir tel ou tel jour, je joue et ils disent : « O c'est un Prodige, c'est inconcevable, c'est étonnant ». Et là-dessus : « Addieu ». J'ai suffisamment dépensé ici pour mes déplacements — et souvent en vain car je n'ai pas rencontré les gens. Si on n'est pas sur place, on ne se rend pas compte combien c'est fatal. D'ailleurs, Paris a beaucoup changé. Les Français sont loin d'avoir autant de Politesse qu'il y a 15 ans. Ils sont désormais bien près de la grossièreté et affreusement orgueilleux. […] Papa chéri, faites en sorte que je puisse bientôt revoir l'Italie, que je puisse y vivre encore une fois. (1er mai 1778)
Il s'ennuie, a des crises de mélancolie, le mal du pays ; il n'aime pas Paris, il n'aime pas les Parisiens — et fréquente surtout des Allemands — et il n'aime pas non plus la musique française :
Le baron Grimm et moi donnons souvent libre cours à notre colère quant à la musique d'ici. N. B. : entre nous. Car in Publico, c'est : Bravo, bravissimo et l'on applaudit tant que les doigts brûlent. […] Mais ce qui m'irrite le plus dans cette affaire, c'est que messieurs les Français n'ont amélioré leur goût que dans ce sens : ils sont en mesure d'écouter aussi de la bonne musique. Mais quant à reconnaître que leur Musique est mauvaise, ou tout au moins à remarquer la différence, Dieu nous en garde ! — Et le chant ! — Ohimè ! — Si seulement les Françaises ne chantaient pas d'airs italiens, je leur pardonnerais volontiers leurs beuglements français, mais gâcher ainsi de la bonne musique ! — C'est insupportable. (5 avril 1778)
Par-dessus tout, Aloisia lui manque :
Je dis entre autres que je ne me plais pas ici — et que cela tient surtout à la musique — que je ne retrouve aucun soulagement, aucune conversation — aucun rapport agréable et honnête avec les gens — en particulier avec les femmes — la plupart sont des catins et les autres n'ont aucun savoir-vivre. […] Finalement, Raff dit en riant : « Oui, je veux bien le croire. Monsieur Mozart n'est pas tout entier ici — pour admirer les beautés qui s'y trouvent — la moitié de lui-même se trouve encore là d'où je viens. » Là-dessus on rit, naturellement, on plaisanta, puis M. Raaf prit un ton sérieux pour dire : « Vous avez raison, je ne peux pas vous blâmer, elle le mérite. C'est une jeune fille bien, jolie et honnête, qui a une bonne conduite, elle est habile et beaucoup de talents. » J'eus alors la meilleure occasion de lui recommander de tout cœur ma chère Weberin ; mais je n'eus pas besoin d'en dire beaucoup, il était déjà prévenu en sa faveur. (18 juillet 1778)
Pourtant, tout n'est pas négatif : le violoniste et corniste Rodolphe lui propose le poste d'organiste à Versailles, ce qui ne l'enthousiasme pas du tout et il refuse. Et Le Gros, pour se faire pardonner son indélicatesse, lui commande une nouvelle symphonie, celle que nous appelons aujourd'hui « Paris », N° 31, K. 297 (300a). Elle remporte un grand succès lors de sa création le 18 juin, mais Le Gros demande cependant à Mozart de refaire l'andante, qui avait été trouvé un peu long et trop modulant. Wolfgang s'exécute, et trouve même son second andante meilleur que le premier. Le Gros lui commande alors une autre symphonie, jouée le 8 septembre, mais on pense aujourd'hui que Wolfgang s'est contenté de donner la partition d'une œuvre déjà écrite à Salzbourg sans le dire à Le Gros… ni à son père.
Il compose également des œuvres pour piano, dont la belle sonate pour piano en la mineur K. 310, sans doute influencée par le maître strasbourgeois Nicolas Hüllmandel, et des séries de variations sur des thèmes français, « Lison dormait » ou « Je suis Lindor », un air de Baudron pour Le Barbier de Séville de Beaumarchais.
Mais le tableau s'assombrit encore. Anna Maria, qu'il abandonnait toute la journée seule dans sa chambre, est malade depuis quelques jours déjà et refuse de voir un médecin français. Mozart charge un ami, Heina, trompettiste des chevau-légers et éditeur de quelques-unes de ses partitions, d'en trouver un. Malgré des soins de pointes — saignée, lavement, rhubarbe en poudre — elle meurt le 3 juillet 1778. Grimm paie les frais du médecin et recueille Mozart chez son amie Madame d'Epinay, qui lui offre le gîte et le couvert. Wolfgang écrit alors à son père que sa mère est malade ; il veut le préparer à l'idée de son décès :
Monsieur mon très cher père,
J'ai à vous donner une très fâcheuse et très triste nouvelle. […] Ma chère maman est très malade […] Elle est très faible, elle a encore de la fièvre, elle délire, on me donne de l'espoir, mais je n'en ai pas beaucoup. — Depuis longtemps déjà, jour et nuit, je suis partagé entre la crainte et l'espérance (je m'en suis remis à la volonté divine) et j'espère que vous et ma chère sœur en ferez autant. […] Maintenant parlons d'autre chose ! abandonnons ces tristes pensées. (3 juillet 1778)
Et dans le même temps, il prévient l'abbé Bullinger, un ami de la famille, pour qu'il annonce lui-même la triste nouvelle :
Très cher ami !
Pour vous tout seul.
Pleurez avec moi, mon ami ! — Ce jour fut le plus triste de ma vie. Je vous écris cela à deux heures du matin. Il faut encore que je vous dise ceci : ma mère, ma chère maman n'est plus ! (3 juillet 1778)
Une semaine plus tard, il présente ses excuses à son père pour lui avoir menti. Mais Leopold s'en doutait bien.
Et puis, très vite, Wolfgang passe à autre chose : il envoie à Fridolin Weber et à Aloisia une lettre assez anodine mais empressée, et demande à nouveau à Bullinger de préparer Leopold à l'idée d'un mariage ; lui-même y fait des allusions transparentes dans ses lettres. Leopold, contrairement à ce qui a été souvent dit, n'est pas hostile à cette idée, il est simplement inquiet : Wolfgang lui annonce fièrement va avoir bientôt assez d'argent pour subvenir aux besoins de toute la famille Weber, alors qu'il ne gagne même pas de quoi se payer un loyer ou la nourriture.
En ce qui concerne Madlle Weber, tu ne dois pas croire que j'ai rien contre cette relation. Les jeunes gens doivent faire l'expérience de cette folie. […] Mais il me semble que si personne ne nous vient en aide, tu ne pourras pas faire grand-chose de positif pour M. Weber, et lui non plus. (3 septembre 1778)
Car, même s'il semble retrouver une certaine énergie à l'idée du prochain mariage avec la belle Aloisia, les choses ne s'arrangent pas. Le duc de Guisnes rechigne à lui payer ses leçons, sa fille s'étant avérée très peu douée pour la composition, et ne lui paye pas du tout le Concerto commandé.
Ce qui m'ennuie le plus, c'est que ces idiots de français croient que j'ai encore sept ans, parce qu'ils m'ont connu à cet âge-là. — C'est vrai, Madame d'Epinay me l'a dit très sérieusement. — On me traite comme un débutant — sauf les gens de musique qui, eux, pensent autrement. (31 juillet 1778)
Les relations avec Grimm s'enveniment. Il doute de ses capacités à jamais venir à bout du grand opéra qu'il rêve d'écrire, lui rappelle qu'il lui doit l'argent des médecins, le traite en petit garçon. Le baron finit par demander à Leopold de le rapatrier ; il lui paiera le trajet jusqu'à Strasbourg. Le père, inquiet, ne peut qu'acquiescer : le voyage est un fiasco, et l'on ne cesse de le relancer pour que son fils accepte le poste d'organiste à Salzbourg. Accepter un tel poste à Salzbourg après avoir démissionné quelques mois plus tôt, c'est une capitulation, une honte pour Leopold autant que pour Wolfgang. Car à Salzbourg, il dit à tout le monde que tout va bien, que Wolfgang gagne de l'argent, est reçu partout, sera bientôt célèbre ; il ne veut pas s'humilier face à ces gens étriqués qu'il déteste tout autant que son fils. Pour cet homme déjà âgé, qui n'a jamais percé dans cette cour provinciale, où il s'est enfermé par amour pour sa femme, le génie éclatant de son fils est une revanche sur la médiocrité. Mais il constate avec déception que Wolfgang est incapable de rien obtenir par lui-même et ne fait que rêver des projets les plus ambitieux et les plus incertains. Il lui conseille d'ailleurs d'aller à Munich ; peut-être Karl-Theodor le prendra-t-il à son service, maintenant ? Et puis Aloisia s'y trouve, elle a été engagée comme chanteuse au théâtre en septembre…
Wolfgang sait bien que son père a raison, et il commence à s'habituer à l'idée. Paris lui déplaît, et où peut-il aller ? D'autant que Leopold l'assure que Colloredo lui a fait des excuses et est prêt à le laisser voyager, cause de sa démission. Mais, vraiment, il a Salzbourg en horreur :
Mon père chéri ! Je dois vous l'avouer, si ce n'était pour le plaisir de vous revoir tous deux, je ne pourrais vraiment pas me décider — et aussi pour quitter Paris que je ne peux souffrir. (11 septembre 1778)
Le 17 septembre, Leopold lui écrit que tout est arrangé avec Grimm et le 26 septembre, le baron le fourre dans la première diligence venue en partance pour Strasbourg. Il s'y arrête près d'un mois à, donne des concerts qui attirent peu de spectateurs, mais trouve un climat plus amical qu'à Paris.
Strasbourg ne peut presque plus se passer de moi ! Vous ne pouvez avoir à quel point on m'honore et on m'aime, ici. Les gens disent que tout est si noble en moi — que je suis mûr — et poli — que j'ai une si bonne conduite. Tout le monde me connaît. (2 novembre 1778).
Il repart cependant et retrouve Mannheim, après avoir dit à son père — qui désapprouvait ce détour coûteux — qu'il se rendait à Stuttgart. Il loge à nouveau chez les Cannabich, et fait des projets pour s'installer. Cette fois, la patience de Leopold est à bout.
Mon très cher fils
Je ne sais vraiment pas ce que je dois t'écrire — je finirai par perdre la raison ou mourir de consomption. Il m'est impossible de me souvenir, sans devenir fou, tous les projets qui te sont passés par la tête depuis ton départ de Salzbourg. […] Tout s'appuie sur des conseils, des paroles en l'air et n'aboutit jamais à rien. (19 octobre 1178)
Et il lui enjoint fermement de rentrer. Le 25 décembre, il est à Munich et court chez Aloisia, qui feint même de ne pas le connaître ; il est désespéré. Mais il semble ne pas lui en avoir tenu tant rigueur. Il épousera sa sœur, Constanze, qu'il a tendrement aimée, et Aloisia et son mari seront des grands amis des Mozart à Vienne. Il demande audience à la princesse électrice Elisabeth Maria Augusta pour lui remettre un exemplaire imprimé de ses sonates pour violon K. 310 à 306 qu'il lui a dédiées. En attendant, Wolfgang est malheureux de voir son amour déçu, inquiet de l'accueil que lui réserve son père, écœuré de devoir reprendre le joug à Salzbourg. Il part le 13 janvier 1779 et arrive à Salzbourg le 15. Le 17 janvier, il est réintégré à la chapelle comme organiste. Son prochain voyage, ce sera Vienne en 1781 ; l'indépendance enfin, la gloire, la mort.
Conclusion
Il faut d'abord parler des conséquences humaines et psychologiques de ce dernier grand voyage. Pour la première fois, Wolfgang est débarrassé de la tutelle de son père et ne dépend plus du bon ou du mauvais vouloir d'un prince. Leopold est d'ailleurs étonné de ne plus trouver en lui la docilité de l'enfant et de l'adolescent. Cette liberté l'enivre, mais il ne sait qu'en faire et cela le conduit à l'échec. Et si Leopold nous paraît aujourd'hui un donneur de leçon parfois pesant, a-t-il tort pour autant ? Car son fils, s'il a acquis une extraordinaire maturité musicale, est loin d'être aussi mûr sur le plan psychologique. Et il sait également, 150 ans avant Freud, qu'un conflit père/fils est inévitable :
Réfléchis à ce qui t'est arrivé dans ta courte vie — réfléchis-y la tête froide, sans préjugés malsains — et tu constateras que je ne te parle pas seulement en père, mais en ami loyal. Car aussi agréable et aimable que soit à mon cœur le nom de fils, aussi détestable est bien souvent le nom de père pour les enfants. (23 février 1778)
Et au moment même où il se détache de son père, son plus grand modèle jusqu'alors, il voit mourir sa mère… Mais cette crise avec son père, salutaire, n'est pas si grave qu'on a pu le dire, ni si incompréhensible : Leopold approche de la soixantaine — ce qui n'est pas jeune alors — et voit avec découragement son fils bâtir mille châteaux en Espagne. Comme tous les pères, il rêve d'un avenir sûr pour son fils, l'imagine titulaire d'un poste fixe dans quelque cour qui lui laisserait la liberté de voyager, de composer, mais surtout de réaliser les espoirs qu'il a placés en lui. Leopold a parfaitement cerné le caractère influençable de son fils, sa fuite en avant, son rejet des responsabilités, et lui écrit une lettre qui semble prophétiser les aléas que Wolfgang connaîtra à Vienne :
Que toi, mon fils, tu écrives que toutes les spéculations sont inutiles, ne servent à rien et que nous ne savons pas ce qui adviendra, c'est vraiment vivre au jour le jour sans réfléchir. Aucun homme sensé, pour ne pas dire chrétien ne saurait nier que tout se fera et doit se faire selon la volonté de Dieu. Mais cela signifie-t-il que nous devions agir aveuglément et vivre sans se soucier, sans prendre de dispositions et attendre seulement que les choses nous tombent du ciel ? […] Comme tout ce qui précède, c'est là le langage d'un désespéré qui veut se consoler lui-même, et moi avec. […] En un mot ! Ce ne sont pas de vaines spéculations que d'échafauder deux ou trois plans lorsqu'on envisage quelque chose et de prévoir des dispositions afin que si l'un d'eux ne fonctionne pas, on puisse avoir sans problème recours à un autre. Quiconque agit autrement est un homme incapable ou léger, qui restera toujours en arrière et sera même malheureux, surtout dans le monde actuel qui exige le plus grand savoir-faire. Il sera en effet toujours abusé par les flatteurs, les fanfarons et les envieux. (4 décembre 1777)
Même si cette analyse n'est pas fausse, il est en tout cas certain que son fils saura se faire des amis prêts à l'aider dans les moments difficiles, surtout grâce à la franc-maçonnerie.
Le séjour parisien n'aura pourtant pas été sans enseignement. Wolfgang a rompu une fois pour toutes avec son passé et s'est libéré de toute contrainte ; on sait en lisant ses lettres que le retour à Salzbourg était, quoi qu'il arrive, voué au fiasco. Il est devenu un adulte. Et ce qu'il a entendu à Paris, comme une conscience plus aiguë de son talent et des possibilités qui s'offrent à lui, induit un changement de style profond. Les œuvres qu'il composera par la suite n'auront plus l'insouciance des œuvres de jeunesse, l'expression s'y fera plus forte, plus dramatique, plus concentrée.
Plus de détails
Entre le surmenage, les hypothèses d’empoisonnement, le dédain après la gloire et jusqu’à un enterrement sans office religieux ni caveau personnel, la fin de la vie de Mozart a laissé place à toutes les hypothèses les plus folles du génie abandonné. Mais l’oubli, si tant est qu’il y en ait eu un, a été de courte durée. Pour accéder au dossier complet : Hommage à Mozart