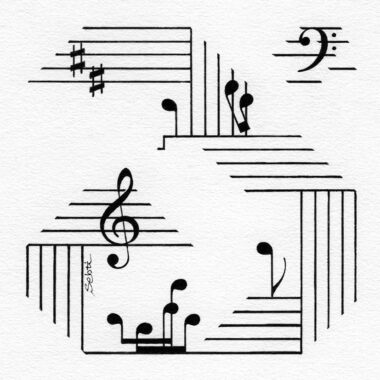Plus de détails
Entretien avec Pascal Dusapin à propos de la création à l'Opéra de Paris Bastille de son opéra Perelà, l'homme de fumée.
 « Au lieu de prendre une forme prédéterminée, j'ai choisi de la comprendre en la démontant. »
« Au lieu de prendre une forme prédéterminée, j'ai choisi de la comprendre en la démontant. »
ResMusica : Avec Perelà, l'homme de fumée, créé le 24 février à l'Opéra Bastille, vous signez à quarante-sept ans votre quatrième opéra. Pourquoi cette quête lyrique depuis le milieu des années 1980 ?
Pascal Dusapin : Avec mon premier ouvrage, Roméo et Juliette (1985-88) sur un livret d'Olivier Cadiot, je cherchais à étudier la façon dont fonctionne l'opéra. Ainsi, au lieu de prendre une forme prédéterminée, j'ai choisi de la comprendre en la démontant. Dans Medeamaterial (1990) d'après Heiner Müller mais fondé comme les suivants sur mon propre livret, j'abordais les questions que posent le grand solo vocal et le tragique. Deux ans plus tard, j'écrivais To be sung d'après Gertrud Stein où je re-démontais la machine, évacuant narration et chant pour ne m'attacher qu'à la seule musique, avec pour problématique la réalisation d'un opéra de chambre à écouter tel un quatuor à cordes. Ainsi, présentant Perelà à l'Opéra de Paris, je savais précisément pourquoi j'avais écrit une vraie histoire.
Mon désir d'opéra naît de la confrontation avec la représentation, la scène, qui est l'un des derniers lieux métaphysiques de l'expression. Lorsque j'ai reçu la commande de l'opéra, je l'avais déjà commencé. Le terme « commande » ne me convient pas parce que j'en obtiens quand j'ai un projet. En fait, je fais toujours ce que je veux. Je n'obéis à personne. J'ai mis des années à mettre au point le projet de Perelà, j'avais donc déjà accumulé quantité de matériaux lorsque l'Opéra de Paris m'a contacté. En tout cas suffisamment pour commencer. La commande m'est arrivée voilà cinq ans, et j'ai achevé ma partition en mai 2001.
RM : Est-ce l'Opéra de Paris qui vous a suggéré ce sujet ?
PD : Je ne conçois pas mes projets sur les idées des autres. J'ai découvert le texte d'Aldo Palazzeschi alors que je composais To be sung. Je suis constamment à la recherche de livres, en vrai collectionneur que je suis. La littérature m'est passion, et je n'ai de cesse de découvrir des auteurs qui me sont inconnus. Ce Code de Perelà d'Aldo Palazzeschi, paru en 1911 puis revu et réédité en 1954, m'a particulièrement intrigué. En outre j'apprécie la politique éditoriale des éditions Allia, qui ont publié la traduction de ce livre et qui publient en ce moment une intégrale Leopardi. J'ai appris voilà un an que ce texte de Palazzeschi n'a jamais été chroniqué ni annoncé dans aucun journal. Ce qui est hallucinant, car il s'agit d'un livre fondamental de la littérature italienne du XXe siècle. J'ai donc découvert cette Perelà, qui m'a tout d'abord intrigué. J'ai néanmoins compris immédiatement que je tenais-là un sujet en or, malgré la masse de personnages et d'événements. Quand j'ai reçu la commande d'Hugues Gall, j'en ai été très heureux, mais je lui ai dit « Je fais Perelà », le prévenant gentiment que s'il n'était pas d'accord, je le proposerais ailleurs. Je lui ai fait livrer le livre le lendemain, et le surlendemain, il acceptait avec enthousiasme.
RM : Que conte Le Code de Perelà ?
PD : L'histoire est fort simple, et son caractère métaphorique. Perelà vient de nulle part. Il a trente-trois ans, et a été engendré par trois mères, Pena, Rete et Lama. Ainsi est-il une métaphore du Christ et de la Trinité, bien que Palazzeschi, devenu fort dévot, s'en soit défendu à la fin de sa vie. Perelà a la particularité d'être fumée, autre métaphore, comme le montrera la mise en scène de Peter Mußbach. Il arrive dans une cité au milieu de nulle part qui a la réputation d'assassiner ses rois. Perelà sera l'objet d'une admiration si éperdue de la part du peuple, que ce dernier, roi et reine en tête, va lui confier la rédaction du code, métaphore des lois régulant tout groupe humain. Il est si extraordinaire qu'un vieux valet tente de l'imiter en s'immolant par le feu après avoir appris que le corps de Perelà est le fruit d'une carbonisation. La société se retourne alors contre son héros, qu'elle condamne à la prison à vie. Victime des fantasmes que son apparence suscite, Perelà, qui a traversé l'opéra en se demandant ce qu'il faisait là, remonte au ciel et s'évapore. Les rapports de cette histoire avec la spiritualité sont évidents, mais ce qui m'a fasciné ce sont ses nombreux degrés de lecture. Du caractère bouffe jusqu'à la métaphysique, il m'était possible de traiter différentes questions, spiritualité de la partition, juxtaposition de moments comiques quasi felliniens, intermèdes particulièrement tragiques. Ce texte m'a également permis d'exploiter les qualités expressives requises par le théâtre. Bref, l'exact contraire de To be sung.
RM : Quand vous avez lu le livre avez-vous vu immédiatement ce que vous pouviez en faire musicalement ?
PD : La musique n'était pas mon problème. J'en faisais de toute façon mon affaire. Je n'ai pas, pour l'instant, trop de problème pour en écrire. C'est le texte qui me passionnait.
RM : Il se trouve des textes si forts qu'il est impossible de les mettre en musique !
PD : Oui ! Je voue par exemple une vraie passion pour Samuel Beckett, mais je n'ai pas mis en musique le moindre mot de lui, et je crois que je ne le ferai jamais. Mais, pour ce qui concerne Perelà, et malgré mon amour pour ce texte, je l'ai abordé d'un point de vue quasi formel. Sortant de To be sung avec la réputation que je m'étais faite en trois opéras, que je ne connais rien au théâtre, je me suis dit que je devais me lancer dans un projet dans lequel les questions du théâtre, de la narration, de la personnification du chanteur sont prises en compte de façon totalement inverse à ce que j'avais fait avec mes projets lyriques, particulièrement dans To be sung. J'avais écrit ce dernier ouvrage pour une petite formation et mettais en scène une « dé-représentation », « une déconstruction ». To be sung est en fait un hymne au chant, comme le suggère le titre qui signifie « Pour être chanté », ce que n'a relevé aucun critique français, contrairement aux étrangers.
« Perelà, malgré mon amour pour ce texte, je l'ai abordé d'un point de vue quasi formel. »
RM : Voilà trois ans, vous m'aviez dit tenir absolument au Palais Garnier pour la création de Perelà, et voilà qu'il se retrouve à Bastille. Pourquoi ?
PD : Il est vrai qu'au début du projet, je pensais Garnier. Ce que Gall avait accepté. En fait, Peter Mußbach, lors de notre première rencontre, a visité les deux théâtres, et a été ébloui par les capacités techniques proprement hallucinantes de la machinerie de Bastille, où il se trouve des endroits où l'on pourrait garer des Airbus ! Je crois néanmoins que si j'avais insisté, il n'y aurait pas eu de problème pour Garnier, mais en fait Mußbach m'a dit quelque chose de très juste qui m'a fait retourner comme une crêpe en l'espace d'une demi-seconde : « A Bastille, le décor est devant toi, et ça c'est mon problème ; à Garnier le décor sera derrière toi. » Il se trouve qu'au même moment James Conlon et l'Orchestre de l'Opéra ont joué mon Extenso à Garnier. Et je me suis retrouvé dans ce théâtre, j'y ai entendu ma musique et ai aussitôt pensé à ce que m'avait dit Mußbach. Le poids du décor de cette salle magnifique est si lourd que quelque chose ne marche pas.
RM : L'un des problèmes de Bastille est l'impossibilité d'entrer dans le son tant tout y apparaît lointain, artificiel, glacé.
PD : Cela dépend de l'endroit où l'on se trouve…
RM : Avez-vous construit votre ouvrage en pensant à la tradition de l'Opéra de Paris ?
PD : Ce projet convient parfaitement aux exigences d'un Opéra National comme celui-ci. Mais je n'y ai pas pensé en composant Perelà, bien que ce projet ait été beaucoup plus lourd à réaliser que les trois précédents, puisqu'il m'a demandé trois ans et demi de travail intense et particulièrement exténuant. Mais cet ouvrage reste un problème d'ordre purement technique. C'est-à-dire que lorsque j'ai conçu To be sung pour le Théâtre des Amandiers, j'ai résolu des questions sur la partition elle-même, sur le projet de la représentation, et sur le lieu et les conditions de travail que me proposait ce lieu. Il est évident que quand je suis à l'Opéra National de Paris, qui plus est Bastille, avec tous les enjeux que ce théâtre présuppose, ainsi que l'immensité de la salle, je suis obligé de me poser la question de l'histoire de cette institution. Je peux l'aborder d'un point de vue social, en me disant « oh la la, c'est pesant, c'est politique, c'est mondain, c'est l'Opéra de Paris », ce dont je me fiche éperdument. J'espère être assez honnête avec moi-même. Il est certain que cet Opéra induit non pas une écriture mais une dimension lyrique tout à fait particulière. Mais Perelà ne pouvait qu'être donné dans un lieu comme celui-ci.
RM : L'orchestre de Perelà est-il plus vaste que ceux que vous avez mis en jeu jusqu'à présent ?
PD : Il nécessite une centaine de personnes, dont trois percussionnistes et un timbalier. Mais ce n'est pas un orchestre hors normes. Les instruments à vent sont par trois ou quatre, et j'y associe une électronique assez discrète, pour engendrer un son que l'on trouvait déjà dans To be sung et qui n'est pas fait pour être clairement entendu. Il s'agit en fait d'un décor sonore réalisé à la Kitchen. Je tenais à ce que tout soit centralisé dans la salle avec les moyens du bord.
RM : Qu'en est-il des chœurs ?
PD : J'ai fait appel à l'Ensemble Accentus de Laurence Equilbey, parce que je confie aux choristes quantité de petits rôles. Il y a même un très bref passage à quatorze voix réelles. L'Opéra de Montpellier, qui reprend l'opéra peu après, utilisera ses propres chœurs. Mais il m'apparaissait important pour la création de disposer d'un chœur qui corresponde pleinement au projet. En outre, cette œuvre n'a pas besoin d'un chœur aussi important que celui de l'Opéra de Paris, mais d'un ensemble de chambre de trente-deux chanteurs qui font beaucoup de choses.
RM : Combien votre opéra compte-t-il de personnages ? Quel est le découpage de l'œuvre ?
PD : Il compte une dizaine de rôles et est divisé en dix chapitres.
RM : Cette idée de chapitres à un côté biblique !
PD : C'est vrai, je n'y avais pas pensé ! C'est en fait un hommage au livre lui-même, Le Code de Perelà.
RM : Comment se présente le livre de Palazzeschi ?
PD : L'édition originale parue sous le titre Le Code de Perelà date de 1911 ; écrite quarante ans plus tard, la seconde édition est intitulée Perelà, uomo di fumo. Ces deux éditions ne se terminent pas de la même façon. La seconde version se subdivise en dix-sept chapitres, et j'en ai adapté dix. J'ai dû couper beaucoup d'éléments. Sinon, c'eût été impossible, à moins de cent cinquante chanteurs solistes. Cette aventure était également littéraire, puisque j'ai réalisé l'adaptation sans toucher un seul mot de Palazzeschi. Tout est extrait du livre, y compris la structure. Le premier chapitre s'étend sur trente-cinq à quarante minutes, le dixième dure deux minutes. Les chapitres s'enchaînent, mais il y a un entracte pour la symétrie. Les quatre premiers chapitres sont plus longs que les six derniers.
RM : Quel rôle attribuez-vous à votre orchestre ?
PD : Il est un individu à part entière. Il fait beaucoup de choses différentes et participe à l'intrigue sans émettre aucun avis. Il n'est pas dans la psychologie de l'histoire, mais est une sorte de factotum. Il accompagne, anticipe, commente, prévient, fait monter le suspens, se fait plus ou moins ludique… Il est très vocal au sens choral de la tragédie grecque. Bref, il s'agit bien d'un orchestre d'opéra à part entière !
RM : Michèle Reverdy, lorsque je l'ai rencontrée voilà trois semaines à l'occasion de la création de son opéra Médée à l'Opéra National de Lyon, m'a dit que, lorsqu'elle compose un opéra, elle commence par écrire les parties d'orchestre avant les voix parce qu'elle en extrait l'essence tout en divisant sa partition en notant le texte sous les portées. Comment procédez-vous pour votre part ?
PD : Tout me vient en même temps. Je ne fais pas de différences entre la voix et l'orchestre. J'écris tout au même moment, de haut en bas et de gauche à droite. Si je prends mon manuscrit définitif, c'est celui sur lequel j'ai travaillé dès le premier jour. Je n'en ai pas d'autre. Pas même de brouillon. J'écris directement à l'encre sur du papier mesuré blanc et de façon chronologique. Parfois, je passe du blanc, mais très rarement. En fait ce sont les copistes qui ont attiré mon attention sur ma façon d'écrire. Depuis la généralisation du Macintosh, voilà un peu plus de dix ans, la musique est recopiée la plupart du temps de façon informatisée. Les copistes qui manient quantité de musiques différentes voient les manuscrits et la façon dont les compositeurs écrivent, et il leur faut parfois arranger des choses. Un jour, l'un d'eux me dit « Mais c'est drôle la façon dont vous travaillez ! ». Je me suis mis aussitôt à interroger mes confrères pour savoir comment ils s'y prenaient. Et chaque fois je suis tombé sur des méthodes différentes de la mienne. Chacun a son truc. Il est vrai que maintenant beaucoup préfigurent leur œuvre à l'ordinateur, maquettent, écrivent des particelles. Pour ma part, je travaille dans la masse, comme un sculpteur, à l'ancienne. J'ai trois mètres cubes de granit, un fin ciseau et un petit marteau, je cogne dans la masse, et ma forme naît de cet évidement progressif des formes, mon imaginaire se créant aussi des accidents. Toc, un éclat sort par mégarde, et de cet éclat survient forcément une idée, car je ne pourrai jamais remettre de la pierre que j'ai enlevée, même par accident. Il s'agit une métaphore, bien sûr, parce que, dans le détail, c'est infiniment plus compliqué. Avoir les idées n'est pas tellement un problème. C'est très simple. Le problème est d'en avoir deux qui se succèdent.
 RM : Lorsque vous composez, vous êtes seul, quoique vous deviez tout de même avoir des échanges avec un certain nombre de partenaires de la création, mais une fois l'œuvre achevée, vous intégrez toute une équipe, ce qui vous conduit à avoir une sociabilité avant que l'opéra ne soit créé.
RM : Lorsque vous composez, vous êtes seul, quoique vous deviez tout de même avoir des échanges avec un certain nombre de partenaires de la création, mais une fois l'œuvre achevée, vous intégrez toute une équipe, ce qui vous conduit à avoir une sociabilité avant que l'opéra ne soit créé.
PD : Je ne pense pas que l'opéra relève d'une quelconque collaboration. Je ne crois absolument pas à ce langage actuel qui consiste à dire que l'opéra est le fruit d'un trio associant un chef, un metteur en scène ou un décorateur, et un compositeur. Je pense que tout cela est du vent. Pour moi, un opéra est d'abord une partition. Ensuite, le compositeur doit avoir les idées assez claires pour savoir quels hommes il va choisir pour travailler avec lui. Je ne veux pas avoir affaire avec un metteur en scène avant la fin de la composition, et je ne veux parler avec lui que pour qu'il me donne des énergies positives. C'est pourquoi je tiens à ce qu'il comprenne le sens de la composition, ce qui est le cas de Mußbach.
RM : Même avec un librettiste ?
PD : J'écris mes livrets, seul ; je fais tout moi-même, et je suis bien plus tranquille ainsi. A vrai dire, j'ai eu une expérience unique avec Olivier Cadiot qui a été passionnante, drôle, intelligente, et je suis allé si loin avec lui dans cet opéra, Roméo et Juliette, où nous avons abordé à fond la question de la collaboration, que je n'ai jamais plus éprouvé le désir de recommencer.
RM : Y compris avec Cadiot ?
PD : Voilà quinze ans que nous en parlons chaque fois que nous nous voyons, notre gag favori étant « Tiens, si nous écrivions un opéra ensemble ». Je pense que Roméo et Juliette ouvre une porte et la ferme immédiatement, contrairement à ce que nous-même avons pu en penser alors. Aujourd'hui, je reconnais éprouver un plaisir fou à être seul. Quand j'ai songé à Perelà, j'ai envisagé de travailler avec quelqu'un, et j'ai fait des tentatives en ce sens. Mais je me suis aperçu que ces gens-là, ce qui est légitime, ont des idées sur l'œuvre. Ce qui m'a fait reculer, et je leur ai dit « Attention, les idées, c'est moi qui les ai, pas vous ». Je ne voulais pas me mettre « au service d'une interprétation », puisque c'est moi qui avais l'idée. Ce que je dis peut paraître arrogant, mais c'est la vérité. Aujourd'hui, j'ai un autre projet d'opéra qui est en chantier théorique depuis des années, il est même antérieur à To be sung. J'avance, je fais les choses, puis j'ai une autre idée, mais souvent ces idées sont antérieures à elles-mêmes, et elles trouvent le bon moment pour émerger. Par exemple l'idée d'aujourd'hui émane de la première forme de To be sung. Mais il lui aura fallu dix ans pour mûrir.
RM : Sera-ce un troisième opéra déstructuré ?
PD : Je n'apprécie guère ce mot, d'autant moins que je passe au contraire mon temps à structurer, bâtir, monter, organiser. En fait, je ne démonte pas, je réfléchis. Ce ne sont pas des questions d'opéra strict mais des questions d'ordre plus spirituel que purement social d'opéra et tout ce discours qui m'ennuie prodigieusement. Je n'ai pas d'idée sur l'opéra. Je croise plein de gens qui en ont, critiques, public – quoique ce dernier ait seul le droit d'en avoir –, compositeurs. Pour ma part, je n'ai aucune. Je fais des opéras, ce qui n'est pas pareil.
RM : Ce cinquième opéra est pour quel théâtre ?
PD : Je ne peux vous le dire. Il est pour un théâtre étranger, mais je n'en révélerai pas davantage.
RM : Ne serait-il pas pour l'Allemagne… Est-ce vous qui en écrivez le livret ?
PD : Oui.
RM : Vous avez composé Roméo et Juliette sur un texte français, To be sung en américain, Medeamaterial en allemand, Perelà en italien. Est-ce que le fait d'écrire chaque fois sur des langues différentes sous-tend un nouveau style ?
PD : L'usage de langues différentes n'est pas innocent, en effet. Il est évident que l'italien ne s'articule pas comme l'allemand ou l'anglais. La langue italienne est plus naturelle pour nous, Français, que l'allemande, voire l'anglaise. Enfin, tout est relatif, car, moi qui ne parle pas l'allemand, lorsque j'ai réalisé Medeamaterial à partir du texte éponyme de Heiner Müller, ce dernier, lorsqu'il m'a vu pour la première fois, m'a dit « Tiens, ce Français doit bien parler l'allemand », alors que je suis incapable d'aligner deux mots d'allemand. Mais j'ai été longtemps bercé par cette langue, lorsque, enfant, je vivais en Lorraine, et j'ai étudié l'allemand jusqu'au bac. Tant et si bien que j'ai fait quelques erreurs, mais légères et peu nombreuses. Pour To be sung, je n'ai pas le souvenir d'une seule faute. Alors que la langue italienne, qui est peut-être celle que je maîtrise le mieux, est celle où j'ai fait le plus de fautes d'accent tonique.
RM : Pourquoi avez-vous écrit ce quatrième opéra sur un texte en italien ?
PD : Parce que c'eût été une faute de le traduire. D'autant qu'utiliser la langue italienne est pour moi une condition particulièrement plaisante, mais très difficile, comme j'ai pu le constater dans le cours des répétitions. Il m'a fallu changer des accents toniques. Non pas parce que je parle un italien de cuisine, j'ai un bon sens de cette langue, mais parce qu'il est presque impossible pour un Français de la maîtriser complètement, à moins de connaître cette langue au plus près de son accentuation. Dans le cas de Perelà, James Conlon, qui parle couramment l'italien et est un magnifique musicien, m'a beaucoup apporté, me disant « là, tu vois, il vaut mieux que l'accent sur ce mot soit posé là, ou alors tu décales le mot ». De temps à autre, j'ai fait de petites fautes d'accent tonique, mais rien de grave.
RM : Les couleurs de votre orchestre reflètent-elles la luminosité charnelle de la langue italienne ? La musique de Luciano Berio ne sonne pas comme celle de Pierre Boulez ou celle de Wolfgang Rihm !
PD : Oui, c'est clair. Et cela fait partie des choses qui me tiennent particulièrement à cœur. C'est-à-dire entrer dans l'esprit d'un univers sémantique aussi complexe que celui d'une langue, et me laisser colorer par lui. Dans le cas de Perelà, il y a la langue, bien sûr, mais aussi la thématique. Il n'en reste pas moins que nous, Français, avons une telle passion pour la langue italienne, nous aimons tellement l'Italie, que j'avais vraiment envie de me confronter à des questions aussi simple que le comique italien. Nous sommes par exemple tous pétris de cinéma italien, en tout cas d'une certaine génération de cinéma italien, et j'avais envie d'un côté spaghetti, ce que seul l'italien peut traduire. En tout cas le rapport que nous, Français, entretenons avec l'italien. Alors quelles sont les incidences véritables de la langue sur ma musique ?… Je suis en fait comme un mille-pattes dans cette affaire, je n'y réfléchis pas toujours. Sinon je ne pourrais plus avancer.
RM : Le mot vous inspire-t-il une certaine orchestration ? Ecrivant vous-même le livret, vous devez penser à la coloration du mot lorsque vous composez…
PD : Je n'ai jamais oublié que le solfège et la mélodie sur lesquels les moines fondaient les textes latins qu'ils psalmodiaient voilà plus de mille ans ne relevaient pas d'une écriture mais d'une lecture. Il suffisait à ces moines de voir les mots pour qu'ils en déduisent l'écriture neumatique qu'ils contiennent. Chaque langue porte ainsi une accentuation mélodique, une couleur qui lui sont propres. Toutes les langues, à l'exception du français. Ce qui est un problème. Et il est vrai que le français, qui est ma langue et que j'aime, ne m'intéresse pas beaucoup à l'opéra. Et tant pis si les spécialistes disent que ce n'est pas bien, où que plus personne ne sait écrire d'opéra en français. La vérité est que ce n'est pas très intéressant. Certes, il se trouve de magnifiques réalisations, Debussy, Dukas, Poulenc, voire Gounod et Berlioz, qui ont un rapport extraordinaire à la langue, mais on ne peut pas lutter avec le Wozzeck de Berg ou les opéras de Puccini.
RM : N'est-ce pas une solution de facilité que de fuir vers d'autres langues et de ne pas essayer de surmonter les problèmes posés par la langue française ?
PD : Je ne suis pas là pour sauver la langue française ! En outre, j'aime la distance que crée une langue étrangère. J'aimerais écrire un opéra en russe, langue dont je raffole. Si, personnellement, de façon privée, j'ai quelques fois un problème avec le français chanté, que l'on me fiche la paix, quoi ! Je ne suis pas payé par le ministère de la Francophonie !
RM : Pourquoi avez-vous choisi Peter Mußbach pour mettre en scène la première production de Perelà, l'homme de fumée ? Le sujet est Italien, le livret et la musique ont été écrits par un Français en langue italienne avec une volonté de coloration italienne, et c'est un metteur en scène allemand qui a été retenu…
PD : Je dois avoir en moi un truc plus ou moins « schtreugeuleu » !… En fait, je cherchais simplement un certain rapport de travail avec un metteur en scène que j'avais précisément défini à Hugues Gall, qui m'a envoyé à Salzbourg pour voir Doktor Faust de Busoni mis en scène par Mußbach. Je suis tombé à la renverse en découvrant cette production en tous points remarquable. J'ai trouvé la mise en scène d'une telle justesse. En outre, je voulais un metteur en scène qui lise la musique, ce qui est le cas de Mußbach, excellent musicien qui a notamment étudié la direction d'orchestre avec Herbert von Karajan. Je ne souhaitais pas me retrouver face à un metteur en scène qui me prenne la tête avec ses conceptions et aille contre ce que je voulais et contre la musique.